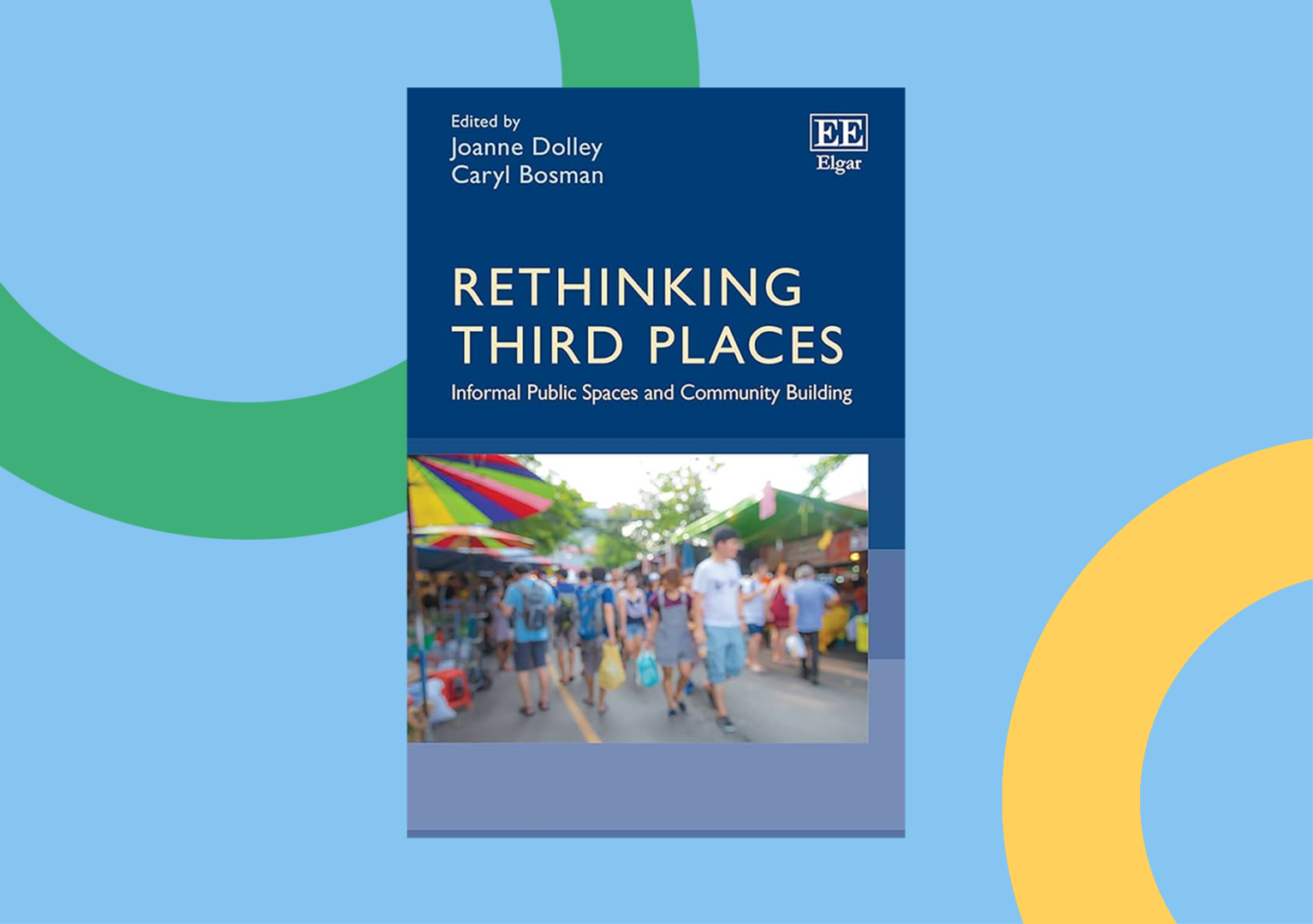Plus de 30 ans après la publication de l’ouvrage fondateur sur les “third place” du sociologue Ray Oldenburg qui définissait pour la toute première fois la notion de « tiers-lieux », Joanne Dolley (Doctorante à l’Institut de recherche sur les villes à l’Université Griffith) et Caryl Bosman (Professeure associée en aménagement et environnement à l’Université Griffith) publient « Rethinking Third Places » (en anglais), une série d’articles scientifiques s’inscrivant dans la définition de Ray Oldenburg. Dans des contextes politiques, économiques, culturels et démographiques différents de celui des États-Unis des années 80-90, les chercheurs et chercheuses apportent chacun·e un éclairage sur comment les tiers-lieux peuvent être intégrés aujourd’hui dans l’aménagement urbain. Y figurent entre autres, les effets des avancées technologiques, l’apport des perspectives féministes, la nécessité de créer des lieux accueillants pour les enfants ou les personnes âgées, le développement des jardins communautaires, ou encore le rôle des archives musicales en tant que tiers-lieux.
Dans la préface de l’ouvrage, Ray Oldenburg donne le ton : « Le présent ouvrage se concentre sur le problème généralisé de la solitude dans les centres urbains, un problème que les urbanistes semblent ne jamais comprendre ni aborder. […] Je suis d’ailleurs très heureux que ce livre soit le fruit du travail de deux femmes, car s’il est un domaine qui a besoin de plus de femmes, c’est bien celui de l’urbanisme. »
Dans cette fiche de lecture, nous vous proposons une synthèse des onze chapitres qui structurent cet ouvrage et qui abordent plusieurs façons de penser les tiers-lieux et leur rôle en tant qu’espace catalyseur de communautés.
Chapitre 1 : Repenser les tiers-lieux et la construction des communautés
Point de départ de l’ouvrage, le premier chapitre – écrit par Joanne Dolley et Caryl Bosman – introduit le concept de tiers-lieux et élabore une critique des différents discours sur la construction des « communautés » par les urbanistes de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui, pour comprendre les relations qu’entretiennent les lieux et les communautés. Il présente le contexte historique et actuel de l’urbanisme dans lequel s’inscrivent les tiers-lieux.
En 1989 Oldenburg définissait le tiers-lieu comme « un concept qui identifie des lieux qui ne sont ni le domicile (premier lieu) ni le travail (second lieu), mais qui sont des « lieux de rassemblement public informel ». Il s’agit de lieux neutres qui permettent aux gens de se rencontrer, d’interagir et de développer un sentiment d’appartenance à un lieu. » (Oldenburg, 1989) Aujourd’hui le concept s’avère encore extrêmement populaire et est réemployé par urbanistes, designers et chercheurs pour (re)penser les espaces publics (librairie, restaurant, café, zone-fumeurs, etc.).
Un retour historique de la légitimation du concept de « communauté »
Pour Oldenburg les tiers-lieux sont importants « parce qu’ils servent de médiation entre l’individu et la société dans son ensemble et qu’ils renforcent le sentiment d’appartenance et de communauté dans les quartiers. » (Oldenburg, 1999) » Ainsi, selon les chercheuses, pour englober le contexte de création de la notion de tiers-lieux et l’intérêt des urbanistes pour celle-ci aujourd’hui, un détour historique est nécessaire, notamment pour comprendre la genèse et l’influence du concept de « communauté » chez les urbanistes.
Les chercheuses affirment que, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, les valeurs attribuées aux idéaux de “community” ou d’une “vie de quartier” par les architectes et urbanistes ont été « réinventées, reproduites et réinscrites comme des vérités universelles et incontestables. » (Dolley, Bosman, 2019, p1) Ce premier chapitre exploite ces discours normatifs et hégémoniques et situe les tiers-lieux comme critiques de ces derniers : « des lieux de rassemblement où la communauté est la plus vivante et où les gens sont le plus eux-mêmes. » (Oldenburg, 1999)
Elles montrent ainsi comment les architectes et urbanistes du XXe siècle, en souhaitant construire des idéaux de communautés, civiles, morales et bonnes, ont renforcé les disparités, les inégalités et ont délimité « les bonnes communautés sociales » des « mauvaises » (p4). Que ce soit les cités-jardins (1898) de l’architecte britannique Ebenezer Howard (1850-1928), opposées aux villes industrielles et polluées, le Colonel Light Gardens (1916), un village urbain inventé par l’Australien Charles Reade « pour des communautés dociles et joyeuses, pleines de stabilité et de conformité » (Dolley, Bosman, 2019, p9) ou la Broadacre City (années 30) de l’architecte américain Franck Lloyd Wright (1867-1959), censé s’intégrer parfaitement aux habitants et à leur environnement naturel, ces concepts utopiques « délimitent en réalité le « nous » inclus du “eux” exclu et déterminent ce qui est « nôtre » et ce qui est « leur » » (p5). Après la Seconde Guerre mondiale, les personnes veulent rentrer chez elles, à la maison. Les cafés et autres espaces de rencontre disparaissent petit à petit pour laisser place aux autoroutes et infrastructures modernes. Les vies sont alors de plus en plus compartimentées, entre le travail et la maison. Dans les années 90-2000, le néo-urbanisme conçoit la notion de communauté autour d’une volonté de réduire l’usage de la voiture ; les modèles urbains se rapprochent alors des villages. Mais encore une fois, seule une partie de la population peut se permettre d’habiter dans ces espaces. Aujourd’hui, beaucoup d’éco-villages « Les techniques d’aménagement des éco-villages reposent sur le fait que la mise à disposition d’équipements locaux et l’accent mis sur la proximité des piétons produiront des interactions amicales et des réseaux locaux. » s’inspirent de la pensée des néo-urbanistes pour créer des communautés, écologiques et inclusives. « Les éco-villages, comme les projets précédents, ont été critiqués parce qu’ils ignorent le modèle existant de la vie contemporaine. » (p13) D’autres critiques considèrent qu’il faudrait plutôt utiliser les infrastructures qui existent déjà, plutôt que de vouloir recréer un nouveau modèle de ville et de vie pour atteindre une réelle soutenabilité.
Au fil du temps, il semblerait que le discours des urbanistes sur l’idéal des communautés n’ait que peu évolué « La plupart d’entre eux restent associés à des aspirations à la « bonne vie », à un monde plus solidaire, plus partagé, plus connecté et plus uni. » Bien que les urbanistes du XXIe siècle restent attachés aux mêmes idéaux de « communautés », il s’est élaboré toute une pensée critique de l’aménagement urbain comme unique solution pour atteindre « the good life ». Aujourd’hui, la perte de sens de la communauté et le sentiment d’appartenance demeurent des sujets très actuels et beaucoup considèrent les tiers-lieux comme solution pour faire baisser le niveau de stress, d’anxiété et de solitude (Hollis, 2013 ; Jacobs, 1996 ; Firth et al., 2011 ; Putnam, 2000).
Cette première base historique nous permet de comprendre « la variété des contextes d’aménagement et de conception dans lesquels les tiers-lieux existent (ou n’existent pas) et dans lesquels les actions locales des résidents peuvent créer des tiers-lieux. » (p.17) Ce premier chapitre introduit le présent ouvrage qui se veut une exploration du rôle des tiers-lieux dans la construction des communautés au sein de sociétés modernes. Les auteures défendent la nécessité de créer des tiers-lieux dans les villes, où 75% de la population vont vivre en 2050 selon les projections de l’ONU, en particulier pour leur “contribution à réduire les niveaux croissants d’anxiété et de solitude et à contribuer ainsi à la santé et au bien-être des individus et des communautés.” (p.2)
Chapitre 2 : Perspectives féministes sur les tiers-lieux (Feminist perspectives on third places)
« L’espace genré des tiers-lieux n’est pas seulement la conséquence des actions individuelles des femmes et des institutions patriarcales, les tiers-lieux sont genrés à partir de l’incarnation des pratiques spatiales, les interactions quotidiennes et les histoires qui sont liées aux forces économiques du capitalisme mondial, aux impératifs d’individualisation des avancées du libéralisme et aux problèmes persistants de l’inégalité sociale. » (Fullagar, Lloyd, O’brien, 2019)
Dans cet article, Simone Fullagar, Kathy Lloyd (présidente du groupe de recherche sur l’activité physique, la culture, le sport et la santé à l’université de Bath, au Royaume-Uni, et professeur associé à l’université Griffith) et Wendy O’brien (sociologue interdisciplinaire à Deakin University) critiquent l’analyse d’Oldenburg d’une « neutralité » universelle des tiers-lieux. À travers différentes perspectives féministes, elles vont au-delà de l’hypothèse selon laquelle la culture des loisirs pratiqués en tiers-lieux serait forcément inclusive et équitable. Elles offrent une relecture féministe du concept d’Oldenburg, où l’analyse des rapports de force genrés révèle que les tiers-lieux ne peuvent pas simplement être assumés comme des lieux « neutres » et « bons ». Elles optent pour une analyse intersectionnelle de l’espace, (Butler, 1990) et définissent le genre comme un aspect de notre identité et de nos relations sociales, que l’on performe dans nos pratiques quotidiennes. L’étude des loisirs étant leur spécialité, elles s’intéressent notamment aux relations entre loisirs et genres au sein des tiers-lieux, et le degré d’accessibilité de ces pratiques et lieux aux femmes.
Dans une première partie, elles reviennent sur le positionnement genré d’Oldenburg : en tant qu’homme blanc de classe moyenne, il prend difficilement en compte d’autres formes d’identités plus marginales. Le droit des femmes à accéder aux tiers-lieux est ainsi contraint par la dichotomie public/privé qui renforce le droit des hommes à exister dans l’espace public. L’usage des lieux par les femmes, est lui, contraint par leur famille, leur travail, mais aussi par la peur du harcèlement et des violences à caractères sexistes et sexuelles. Dans certains contextes (2e partie), les tiers-lieux facilitent tout de même la connexion sociale et permettent aux femmes de gagner du pouvoir. En étudiant un club de loisirs de femmes âgées, Julie Stafford Son, Careen Yarnal et Deborah Kerstetter notent combien le club est vecteur de liens sociaux, de reconnaissance et un moyen pour résister à l’âgisme. La troisième partie s’intéresse au concept de « male gaze » et son application dans l’espace public ; en sexualisant le corps des femmes, le regard masculin les rend soit visibles, soit invisibles dans l’espace public. Ainsi, certains corps « hors-normes » auront plus de mal à se sentir en adéquation avec des lieux codifiés par le regard masculin. Dans une dernière partie, elles s’intéressent aux tiers-lieux virtuels et montrent le paradoxe d’internet, qui favorise la création de communautés bienveillantes et « empouvoirantes », tout en démultipliant les violences sexistes et sexuelles. En guise d’ouverture, elles recommandent une approche féministe des tiers-lieux qui prendrait compte des relations « sur-humaines » – avec les plantes, les animaux et les objets – et qui permettent de penser la ville, et les tiers-lieux, comme une expérience viscérale et affective (Pink, 2011).
Chapitre 3 : L’urbanisme pour mieux vieillir : comment l’utilisation des tiers-lieux contribue à l’aide sociale des personnes âgées (Planning for healthy ageing : how the use of third places contributes to the social health of older populations)
Dans un contexte de vieillissement de la population mondiale, les chercheuses Sara Alidoust (Chercheuse en urbanisme à l’Université de Queensland) et Caryl Bosman (Professeure associée en aménagement et environnement à l’Université Griffith) s’intéressent à l’inclusion des personnes âgées dans l’urbanisme de la ville, et notamment le rapport qu’elles entretiennent avec les tiers-lieux. Elles se demandent ainsi comment les tiers-lieux affectent la vie sociale des personnes âgées qui vivent en MPC (Master Planned Community : ensemble résidentiel conçu sur un plan directeur global et spécifique avec des limites physiques distinctes et un design esthétique uniforme) et en banlieues conventionnelles (qui sont constituées en majeure partie de maisons individuelles). En se basant sur l’étude des liens sociaux (caractérisés de fort, faible ou très faible), elles cherchent à savoir le degré de liens qu’entretiennent les personnes âgées avec les tiers-lieux. Pour répondre à leur problématique, elles dirigent plusieurs entretiens avec des personnes (21 hommes et 33 femmes) de 65 ans et plus sur la Gold Coast australienne : à SouthPort (banlieue conventionnelle), Hope Island (MPC) et Mermaid Waters (banlieue conventionnelle). La plupart des répondants de l’étude affirment que lorsqu’ils ne sont pas chez eux, ils sont dans des tiers-lieux. En général, ils apprécient ces lieux qui leur permettent de créer du lien et de contrer la solitude habituelle, par ailleurs appartenir à un club est extrêmement important pour eux : c’est à la fois stimulant et valorisant. Au travers des entretiens, les chercheuses notent que plus le tiers-lieu est proche du lieu de résidence (et accessible en transports en commun), plus le lien est fort avec le tiers-lieu. Bien que beaucoup se rendent dans les tiers-lieux avec leurs amis, certains, à force de fréquentation, finissent par créer d’autres liens caractérisés de « faibles », mais nécessaires contre le stress, la solitude et l’aliénation. En conclusion, les auteures soulignent l’importance du rôle du design et de l’aménagement urbain comme outil de maintien de la santé sociale des personnes âgées.
Chapitre 4 : Des tiers-lieux adaptés aux enfants (Child-friendly third places)
Geoff Woolcock est chercheur à l’institut des régions résilientes de l’Université de Queensland du Sud et professeur associé à l’Université Griffith. Dans son chapitre, il s’intéresse particulièrement aux tiers-lieux de par leur fonction de lien social et de convivialité en faveur du public des enfants. Il prend notamment l’exemple des South Bank Parklands à Brisbane en Australie.
En introduction, il retrace l’intérêt pour la recherche et des programmes des Nations Unies depuis les années 1960 sur les liens entre le développement urbain et le bien-être des enfants. Des projets tels que “Growing Up in Cities” piloté par l’UNESCO en 1968, ont pu notamment s’interroger sur l’influence des conditions environnementales sur la psychologie des enfants. Depuis les années 80, bien que des recherches aient pu porter sur l’impact de l’environnement physique sur le développement social et mental des enfants, peu de politiques publiques ont été mises en place sur ce sujet. La récente initiative de l’UNICEF “Child-Friendly Cities” a remis à l’ordre du jour les enjeux autour de l’activité physique des enfants en ville suite à la multiplication des problèmes de santé et d’obésité en particulier dans les pays occidentaux. En effet, Woolcock dresse un tableau inquiétant de l’obésité infantile, de l’inactivité et de la déconnexion sociale et plaide pour l’importance de tiers-lieux bien conçus qui « non seulement accueillent les enfants, mais établissent également des liens sociaux et psychologiques qui stimulent l’apprentissage et, en fin de compte, la participation civique active » (p.64). Par ailleurs, selon les Centres for Disease Control and Prevention (CDCP, 2014) moins de la moitié des enfants américains ont un espace de jeu à une distance de marche acceptable depuis leurs maisons.
Puis, il questionne “l’habitabilité urbaine” et en quoi est-elle adaptée aux enfants. Il met en avant des enquêtes et études qui s’intéressent peu aux avis et retours d’expériences d’un public “enfants” dans l’utilisation des espaces urbains ou dans leurs perceptions de leur bien-être par rapport à leur environnement. Il cite alors plusieurs études menées début des années 2000 présentant des indicateurs relatifs à la protection des enfants centrés sur les besoins physiques des enfants. Le projet “Child-Friendly by Design” dans la région d’Illawarra (Langridge and Woolcock, 2010 Langridge and Woolcock, 2010, « Bringing chrild friendly by design to the heart of liveable cities – the Illawarra experience« , Healthy Cities National Conférence, Brisbane, july.) a notamment demandé aux enfants et leurs parents leurs perceptions de l’environnement physique en utilisant des photos des espaces de plein air en ville et de les classer en fonction de leur potentiel de “convivialité” et d’adaptabilité pour les enfants. Il cite également l’exemple européen dans la ville de Coriandoline dans le nord de l’Italie où des centaines d’enfants depuis la maternelle à l’école élémentaire ont pu s’impliquer activement dans le design et la construction de la fabrique de la ville et des espaces environnants.
Puis, il présente son cas d’étude : le Parkland de South Bank à Brisbane qui avait été construit originellement pour l’exposition universelle de 1988, devenu un lieu attirant particulièrement les familles avec enfants. Il observe des caractéristiques de parc, proche de celles données par Oldenburg aux tiers-lieux : “character” un lieu avec sa propre identité ; “Continuity and enclosure”, un lieu où le public et le privé se distinguent/sont séparés ; “Quality of the public realm” espace extérieur inclusif, notamment des personnes pouvant être âgées ou handicapées ; “Ease of movement” : mobilité et accessibilité ; “Legibility”, où les personnes peuvent se repérer facilement dans l’espace ; “Adaptability” : adaptabilité en fonction des changement sociaux, économiques etc ; “Diversity” : mixité des usages répondant aux besoins des bénéficiaires. Ainsi, pour Woolcock “Pour les enfants et les jeunes, les environnements extérieurs tels que les South Bank Parklands ne sont pas seulement des endroits typiques pour jouer, mais fournissent également un lieu de socialisation, d’activité physique, d’exploration, d’amusement, de « sortie », de contact avec la nature, d’évasion de l’intérieur, ou tout simplement de liberté par rapport aux contraintes d’un monde de plus en plus adulte.” (p.65).
Ce chapitre analyse donc l’importance des tiers-lieux pour la santé et le bien-être des enfants et des jeunes ainsi que la nécessité de “re-moduler” les structures sociales des villes pour s’adapter à leurs besoins, en prenant en compte les perceptions de ce public souvent exclu de la fabrique de la ville. Enfin, il présente les caractéristiques des tiers-lieux accueillants pour les enfants, notamment les possibilités de jeux non structurés, stimulants et aventureux (mais sûrs).
Chapitre 5 : Planifier des tiers-lieux grâce à un développement urbain fondé sur des données probantes (Planning for third places through evidence-based urban development)
Elizelle Juaneé Cillier (Professeure d’urbanisme et d’aménagement du territoire, spécialisée dans le développement durable, la planification des infrastructures vertes et la qualité de vie à l’Université de Technologie de Sydney) dans le chapitre 5 vise à démontrer la valeur et le rôle de la planification dans la création et la recréation d’espaces publics qui sont des tiers-lieux ; des lieux neutres qui permettent aux gens de se rencontrer et d’interagir et de développer un sentiment d’appartenance à un lieu. Pour ce faire, elle identifie un certain nombre d’éléments de conception pour soutenir la mise à disposition et la récupération de tiers-lieux dans les contextes urbains contemporains.
À travers l’étude des trois différentes approches de la planification et de l’aménagement urbain le “place making” (c’est à dire un plaidoyer pour un retour de l’espace public aux habitants par leur implication dans la transformation et construction de ces espaces), la “planification verte” (en référence à la planification stratégique des espaces, infrastructures et réseaux dits “verts”) et “planification vivante” (ou “lively planning” qui signifie une approche controversée de l’aménagement urbain, se focalisant sur les éléments vivants, les fonctions et interactions pour améliorer les espaces urbains et prenant particulièrement en compte les différentes échelles de la ville, du quartier, du site etc;) ; elle établit un cadre fondé sur 4 indicateurs (espaces sociaux, espaces économiques, espaces environnementaux, espaces physiques). Ensuite, à partir de ce cadre théorique, elle liste pour chacune de ces approches, leurs caractéristiques liées à la conception et à la fabrique de la ville”. En recroisant chacune de ces caractéristiques, elle fait ressortir des indicateurs communs aux trois approches théoriques, dont elle se sert pour analyser cinq études de cas internationales dans le but de conseiller / aiguiller la création de tiers-lieux à travers l’aménagement urbain et “reclaim public space for public use”. Ses cinq cas d’étude sont : le jardin public “Jardin de la Maison à Namur en Belgique, Place des Wallons à Louvain-La-Neuve et un espace de parking, la place du Cardinal Mercier à Wavre, le quartier résidentiel d’Eindhoven dans les Pays-Bas, et enfin un espace pour enfants à Ikageng en Afrique du Sud. L’analyse de ses données de terrain lui permet de constater que les principaux éléments de conception et des pratiques à prendre en compte lors de la planification de tiers-lieux (sur la base de la fréquence d’utilisation dans les études de cas sélectionnées) comprennent les valeurs esthétiques, le sens du lieu, les initiatives vertes, les activités sociales de qualité et la diversité des utilisateurs. On aurait apprécié davantage de détails sur la construction des pratiques au sein des tiers-lieux et de ces éléments communs aux trois approches. Le chapitre se conclut par un défi global : « pour changer la vie, nous devons d’abord transformer les espaces en tiers-lieux. ». (p.91).
Chapitre 6 : Les yeux dans la rue : le rôle des « tiers lieux » dans l’amélioration de la sécurité perçue dans les quartiers (Eyes on the street : the role of « third places » in improving perceived neighborhood safety)
Dans le chapitre 6, Gordon Holden (architecte et urbaniste) s’inspire de l’expression “eyes on the street” tirée de l’ouvrage de Jane Jacobs “The Death and Life of Great American Cities”, pour examiner le rôle du troisième lieu dans l’amélioration de la sécurité perçue. Holden se concentre sur les aspects multidimensionnels et interconnectés de la sécurité perçue et réelle dans le contexte des troisièmes lieux dans les quartiers. Il commence dans son chapitre par définir, par la littérature, les concepts de “perception”, “sécurité”, “voisinage” et du terme de Jane Jacobs “eyes on the street”. Il discute des complexités entourant le concept de quartier et des arguments positifs en faveur des « yeux sur la rue » dans les environnements urbains comme moyen de créer des zones de sécurité perçues et réelles. Il cite notamment les trois caractéristiques principales pour des quartiers sécurisés données par Jane Jacobs : “une démarcation claire entre les espaces publics et privés ; le besoin des “yeux sur la rue” par ceux qui sont les naturels “propriétaires” de la rue et les trottoirs doivent avoir de manière assez permanente des piétons, s’ajoutant aux nombres de “paires d’yeux effectifs”.
Puis, il présente la méthodologie et les 8 quartiers situés à Queensland (environ 600 000 habitants, ville côtière centrée autour du tourisme, et la ville australienne présentant la plus forte croissance démographique) de son enquête, présentant une diversité de profils socio-économiques et d’implantation urbaine (plutôt péri-urbaine, résidentielle, à l’exception d’une en semi-rurale, d’une “gated-community” et d’un éco-village). Il a donc interrogé quatre quartiers urbains à partir de plusieurs indicateurs qui ont été notés de 1 à 5 : forme urbaine, profil socio-économique, présence ou non de tiers-lieux (sont considérés : les parcs, les cafés, les clubs sociaux, les églises, les épiceries/commerces, les points de vente d’alcool), la présence d’éléments liés à la sécurité (eyes on the street, accessibilité, état de “vétusté” des bâtiments, environnements piétons, éclairage, niveau d’activité), et le niveau réel et actuel de “criminalité”.
Holden propose que les troisièmes lieux contribuent à « l’attention portée à la rue » et donc à la sécurité parce que ces lieux agissent comme des “nœuds”, attirant la participation et l’interaction du public. À l’aide de quatre études de cas sur la Gold Coast, en Australie, il explore la présence ou l’absence de tiers-lieux dans le contexte de la criminalité enregistrée dans ces lieux. Il conclut que les troisièmes lieux peuvent contribuer de manière significative à la fois à la perception et à la sécurité réelle d’un lieu et à la baisse des taux de criminalité bien que l’enquête révèle que ce qui compose ce qu’il nomme les “eyes on the street” a un impact plus significatif que les tiers-lieux seuls sur la perception de la sécurité.
Chapitre 7 : Comprendre l’héritage de la pratique musicale à travers la lentille des tiers-lieux (Popular music heritage through the lens of “third place”)
Dans cette revue de littérature, le concept de « tiers-lieux » comme l’entend Oldenburg est réactualisé : « il y a dans nos vies contemporaines, d’autres types de lieux liminaux, qui pourraient également être catégorisés comme des tiers-lieux. » À travers quatre études de cas, la revue montre comment le « patrimoine musical populaire » peut s’apparenter à la définition d’un tiers-lieu. Ici, le patrimoine musical est considéré comme existant grâce au collectif (public), la mémoire et l’histoire ; la musique n’étant qu’une pièce du puzzle.
Dans la première étude, Sarah Baker (professeure de sociologie culturelle, Université de Griffith) tisse des liens entre les critères qui « font tiers-lieux » selon Oldenburg et les lieux d’archives musicales. En analysant 23 institutions DIY Comme The Heart of Texas Country Music Museum, le Tonlistarsfn Islands Museum ou encore l’Australian Jazz Museum et en interrogeant plus de 125 « travailleurs du patrimoine », elle montre que les archives musicales sont des lieux intergénérationnels, qui permettent de rencontrer des personnes, de développer des conversations et de faire partie d’une communauté d’intérêts : « tous disent que les archives sont des lieux pour vivre, que faire partie de cette communauté dans un sens à leur vie, et permet de faire fonctionner leur cerveau et de garder l’esprit actif. »
Jez Collins (fondateur et directeur du Birmingham Music Archive), quant à lui, se penche sur les archives de la musique en ligne. Il oppose à la vision très critique d’Oldenburg du numérique, une analyse plus modérée de la possibilité de faire tiers-lieux en ligne Il cite notamment les chercheurs Soukub et Wright qui considèrent les réseaux sociaux comme un moyen de partager un espace symbolique commun (et non localisable). À travers l’analyse des posts Facebook de The Birmingham Music Archive, et du groupe Facebook The Golden Age of British Dance Bands, il montre l’engouement des personnes à se remémorer et partager des souvenirs musicaux communs et à créer des communautés bienveillantes en ligne. Son analyse montre que les groupes en ligne permettent non seulement d’échanger du savoir et des souvenirs mais aussi de se voir en dehors du monde virtuel.
Du côté de Melbourne, Catherine Strong (maître de conférence du programme « musique » au RMIT Melbourne) prend comme terrain de recherche les « music walking tour », comme expérience 360 qui célèbrent les endroits phares de l’histoire musicale de la ville. Elle note combien la plupart des sites qui sont présentés dans le City Tour mettent en avant les fonctions de tiers-lieux caractérisés par Oldenburg (les bars par exemple), mais ils ne sont pas tous pour autant vécus comme des tiers-lieux pendant le « tour », cela dépendra de l’heure à laquelle il est effectué.
Simone Driessen (chercheuse dans le département de média et communication de l’Université d’Erasmus à Rotterdam) étudie de son côté « The Reunion Tour », les tournées musicales d’artistes qui se retrouvent après avoir été séparés pendant longtemps. Bien qu’ils permettent de créer des communautés de fans, leur caractère ponctuel les empêche d’être réellement désignés comme « tiers-lieux ». Cette revue de littérature montre finalement les différents degrés d’appartenance au concept de tiers-lieux des pratiques de « patrimoine musical populaire. »
Chapitre 8 : Tiers-lieux et capital social : étude de cas de jardins partagés (Third places and social capital : case study community gardens)
Ce chapitre écrit par Joanne Dolley, co-coordinatrice de cet ouvrage et doctorante à l’époque de publication du livre à l’université de Griffith, interroge l’aspect de “communauté” (community) des jardins communautaires, en utilisant le concept de troisième lieu pour explorer la manière dont les jardins communautaires peuvent contribuer à la construction d’un capital social et d’un sentiment d’appartenance à la communauté. Les hypothèses de l’autrice sont que les jardins communautaires favorisent la création de liens faibles (bridging capital) entre les membres, les voisins et les visiteurs dans le voisinage local, ainsi que, pour certains membres, ils agissent également comme des clubs qui peuvent renforcer les liens faibles en liens forts d’amitié (capital d’attachement). Après avoir fait une brève revue de la littérature sur les jardins communautaires, ou “partagés” (traduction française du terme de community gardens), elle revient sur les huit caractéristiques du tiers-lieu et utilise un exemple de la littérature sur les jardins partagés pour illustrer chacun de ces traits singuliers. Le cadre théorique utilisé pour ce projet de recherche est le capital social défini par Putnam comme “se référant aux connexions parmi les individus – [c’est-à-dire] les réseaux sociaux et les normes de réciprocité et de confiance qui en découle” (p.140) – et plus particulièrement les « liens faibles » de Granovetter.
Ensuite, elle présente sa méthodologie de recherche et les deux terrains d’étude en Australie et Danemark, où elle a interrogé 29 jardiniers (membres fondateurs et bénévoles) sur cinq jardins en Australie et deux au Danemark, qui sont tirés de sa recherche doctorale sur 8 jardins partagés, pour enfin, présenter ces résultats. Son étude montre notamment que tous les jardins communautaires ne sont pas des tiers-lieux pour l’ensemble des huit caractéristiques des tiers-lieux, ne respectant pas par exemple le “neutral ground” comme critère de définition des tiers-lieux : certains jardins partagés sont animés par des personnalités fortes, ou où l’on peut devenir membres via une adhésion/cotisation et parfois un accès à un portail fermé à clé. Pour autant, son enquête révèle que les jardins cultivent des relations formelles et informelles avec le reste de la “communauté” ou du voisinage, et sont tous inclusifs en termes d’âge, d’ethnicité, et de statuts socio-économiques, ce qui indique bien qu’ils ont un potentiel “d’accroissement du capital social” du quartier. Enfin, le chapitre donne des exemples de la manière dont les jardins communautaires peuvent agir en tant que tiers-lieux. Les résultats permettent de repenser la conception des tiers-lieux et des jardins communautaires, lorsque l’objectif est de renforcer le capital social et le sentiment d’appartenance à la communauté.
Chapitre 9 : “Tiers lieux dans l’éther qui nous entoure : des « couches » sur le monde réel” (Third places in the ether around us : layers on the real world)
Dimitri Williams, professeur associé à l’USC Anneberg School for Communication and Journalism, et Do Own Kim, doctorant en communication et journalisme à l’Université de Californie du Sud, s’intéressent aux possibilités « de faire », « d’être » tiers-lieux au-delà du monde réel. Alors que les nouvelles technologies et réseaux sociaux sont qualifiés de « cauchemar » par Oldenburg, ils proposent de nuancer cette vision avec plusieurs exemples de communautés virtuelles.
En première partie, il présente leur méthodologie de recherche qui se base sur la « la théorie des richesses des médias » Cette théorie suggère que les performances d’une communication peuvent être améliorées en fonction des médias utilisés. et sur le modèle « SIDE » Social identity model of deindividuation effects (SIDE) est une méthode d’analyse pour comprendre les agissements d’un individu au sein d’un groupe. qu’ils associent aux critères « tiers-lieux » d’Oldenburg pour analyser différentes interactions en ligne : les MMO (massively muliplayer online games), la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ils délaissent les notions de « réel » et de « virtuel », et leur préfèrent la notion de « couches » qui se superposent. Ils prennent pour exemple les groupes de jeux en ligne, qui ajoutent une première couche de sociabilité à notre modèle initial et montrent qu’ils permettent beaucoup plus de mixité puisqu’ils requièrent uniquement un même centre d’intérêt, par ailleurs le principe de compétition du jeu, en fait également un lieu « éleveur ». Et face aux critiques du « manque de profondeur dans les relations », les chercheurs observent que certaines relations n’auraient jamais pu se créer si le jeu en ligne n’avait pas existé.
Les « couches » vont encore plus loin avec la « réalité augmentée » et la « réalité virtuelle » où la réalité n’est pas vue comme un espace monolithique, mais plutôt comme remplie de différentes couches. Dans le monde connecté, la principale préoccupation est ce qui a été vécu et par qui (pas si c’est réel ou virtuel). Dans la réalité augmentée, par exemple, « un parc peut devenir une agora grecque ou une allée de bowling » et ajouter une couche « tiers-lieux » à la réalité. Selon les chercheurs, il incombe aux développeurs de ces réalités augmentées et virtuelles d’être ultra-conscients des valeurs qu’ils attribuent en ligne pour construire des architectures et expériences qui nous amènent à faire ensemble plutôt qu’à nous séparer. « Ce qui sera essentiel, c’est une nouvelle forme d’éducation aux médias dans laquelle les gens de tous les jours seront conscients de la valeur encodée dans leurs technologies. » (p.170)
Chapitre 10 : Le tiers-lieux en transit : les transports publics en tant que troisième lieu de mobilité (third places in transit : public transport as a third place of mobility)
Le chapitre 10 porte sur les transports publics en tant que troisième lieu. Daniel O’ Hare (chercheur dans le département de développement durable de Bond University) se demande si le trajet en transports publics, historiquement une expérience linéaire entre le lieu de travail et le domicile, peut être un troisième lieu plutôt qu’une navette sans âme à mettre entre parenthèses avec le « travail », à l’opposé du « domicile ». En 2016, en Australie, à Sidney, seulement 27% de tous les déplacements entre le domicile et le travail se font en transports en commun, et en dessous de 20% dans toutes les autres villes australiennes.
O’Hare examine l’évolution de la nature et de la forme du travail et établit un lien avec la conception des villes et l’expérience des “banlieusards” (commuters). Il part du principe que de nombreux jeunes adultes d’aujourd’hui (en 2018) choisissent de ne pas conduire et que, par conséquent, l’utilisation des transports publics, les modes de déplacement plus “actifs” et les tiers-lieux sont en plein essor. Les transports publics façonnent et remodèlent continuellement le niveau d’interaction avec les passagers, la conception des véhicules et des espaces d’attente (arrêt de bus par exemple) facilitant ou limitant certains types d’interactions sociales.
Aussi, selon lui, l’utilisation de la technologie mobile permet à de nombreux usagers des transports publics de se connecter à des communautés virtuelles et de transformer ainsi le voyage en un tiers-lieu. Il cite également Walker (2012) « Human Transit », Washington DC:The Island Press sur les conditions de base au civisme qui se retrouve aussi bien dans un transport public que dans un tiers-lieu : “un service de qualité, le respect des délais, le rapport qualité prix, la sécurité, la sûreté, la propreté et le confort”. De même, il fait référence aux travaux de Mehta et Bosson (2010) « Third places and the social life of streets », Environment and Behavior, 42 (6), 779-805 sur les grandes avenues des centres-villes qui trouvent 4 caractéristiques physiques aux arrêts de transports publics facilitant la vie sociale à l’instar des tiers-lieux : la personnalisation, la perméabilité, l’assise et l’abri. Ils insistent également sur l’importance de tiers-lieux de type café, bars, librairies à proximité des arrêts de bus, métro ou autres, ainsi que des “nœuds” de transports publics facilement praticables à pied. Enfin, l’auteur du chapitre, Daniel O’Hare fait souvent référence aux autres chapitres de l’ouvrage notamment du chapitre 8 sur les jardins partagés, ils donnent plusieurs exemples d’anciennes gares de train désaffectées ou de lignes ferroviaires (la Highline à New York, ou la petite ceinture à Paris) qui sont devenues des lieux de quartier où se développent des activités d’artisanat ou même des jardins communautaires.
Le chapitre se termine par un appel à une plus grande reconnaissance des transports publics en tant que tiers-lieu à « apprécié plutôt que subi », et par le fait que des transports publics bien conçus et bien gérés contribuent à la création de villes centrées sur les habitants.
« Il est essentiel que nous les concevions et les gérions [les transports publics] d’une manière qui contribue à la « grande qualité de vie » que les gens attendent de leurs villes. (p.193) »
Chapitre 11 : La contribution des tiers-lieux à“l’ambiance” ou la vie de la rue (Third places and their contribution to the street life)
Le dernier chapitre, rédigé par Leila Mahmoudi Farahani et Devis Beynon (Chercheurs en étude d’urbanisme au RMIT University) se concentre sur les rues en tant que sites d’activités du tiers-lieu. En analysant les séquences vidéo prises de manière discrète dans la rue des interactions qui se produisent le long de quatre rues commerçantes de la ville de Greater Geelong, dans l’État de Victoria, il a été établi que les trottoirs, les cafés et les restaurants, les magasins et les zones d’interaction telles que les croisements de rues agissent, à des degrés divers, comme des tiers-lieux, du moins ceux prenant la forme de café, bars, restaurants car ce sont eux qui créent une atmosphère de sociabilité dans les centres-villes. Leur méthodologie d’analyse vidéo de l’utilisation de l’espace et leur représentation des résultats sous forme de diagrammes offrent un niveau de détail unique des interactions entre les tiers-lieux.
En utilisant leurs données et en se référant théoriquement aux idées de Lefebvre sur les significations de l’espace, ils sont en mesure de commenter ce qui fait la vitalité et l’activité d’un paysage de rue et de proposer des caractéristiques de conception qui peuvent améliorer l’aménagement des troisièmes lieux. En particulier les qualités physiques des tiers-lieux qui peuvent influer sur la vie sociale des rues sont : la “personnalisation” (c’est-à-dire selon Mehta (2009) l’acte de modifier l’environnement physique afin de se l’approprier comme territoire), “soft edges” défini par Gehl (2010) comme les frontières indistinctes entre les espaces publics et privés et signifie l’importance donnée aux mobiliers urbains, à la perméabilité entre les espaces intérieurs et extérieurs d’un bâtiment à travers des vitrines ou des façades “attractives”, etc. ; et enfin le paysage et la verdure. Les auteurs concluent leur étude en précisant que les tiers-lieux prenant la forme de cafés ont davantage de succès dans le quartier lorsque la devanture du magasin a été personnalisée, lorsque les voies piétonnes sont larges et qu’il y a suffisamment d’espace pour une salle à manger. En outre, la personnalisation ou la définition des limites de la zone de restauration par des éléments physiques tels que des panneaux et des abat-jours sont des facteurs essentiels de la popularité de la restauration sur le trottoir. Une “légère” façade, perméable et transparente sont d’autres qualités physiques qui peuvent influencer la popularité de terrasses. Dans les rues où ces qualités font défaut, les gens évitent les repas en terrasse et les tiers-lieux sont attirés vers l’intérieur, ce qui signifie une activation moins visible du quartier.
Les résultats améliorent et élargissent notre compréhension des caractéristiques physiques qui influencent la vie sociale et les modèles d’activités dans les rues commerciales et prouvent que la restauration en terrasse et sur les trottoirs joue un rôle important dans la création de centres de quartier vitaux.
Conclusion
“Les tiers-lieux sont des lieux neutres et ouverts qui servent de “niveleurs” pour rassembler les résidents locaux de différentes ethnies, âges, sexes, statuts socio-économiques, niveaux d’éducation et centres d’intérêt. Les tiers-lieux sont des lieux de diversité où chacun est le bienvenu, libre d’aller et venir et de se sentir à l’aise. Les tiers-lieux peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration des interactions sociales dans les quartiers. Ray Oldenburg, le créateur du concept, a énuméré de nombreux exemples de tiers-lieux, tels que les parcs, les cafés et les “piazzas”, où les gens peuvent se rencontrer de manière informelle. Ce livre est une exploration opportune du rôle des troisièmes lieux dans la construction de relations communautaires dans une société moderne très urbanisée et mobile.” (p.17)

Cet article est publié en Licence Ouverte 2.0 afin d’en favoriser l’essaimage et la mise en discussion.