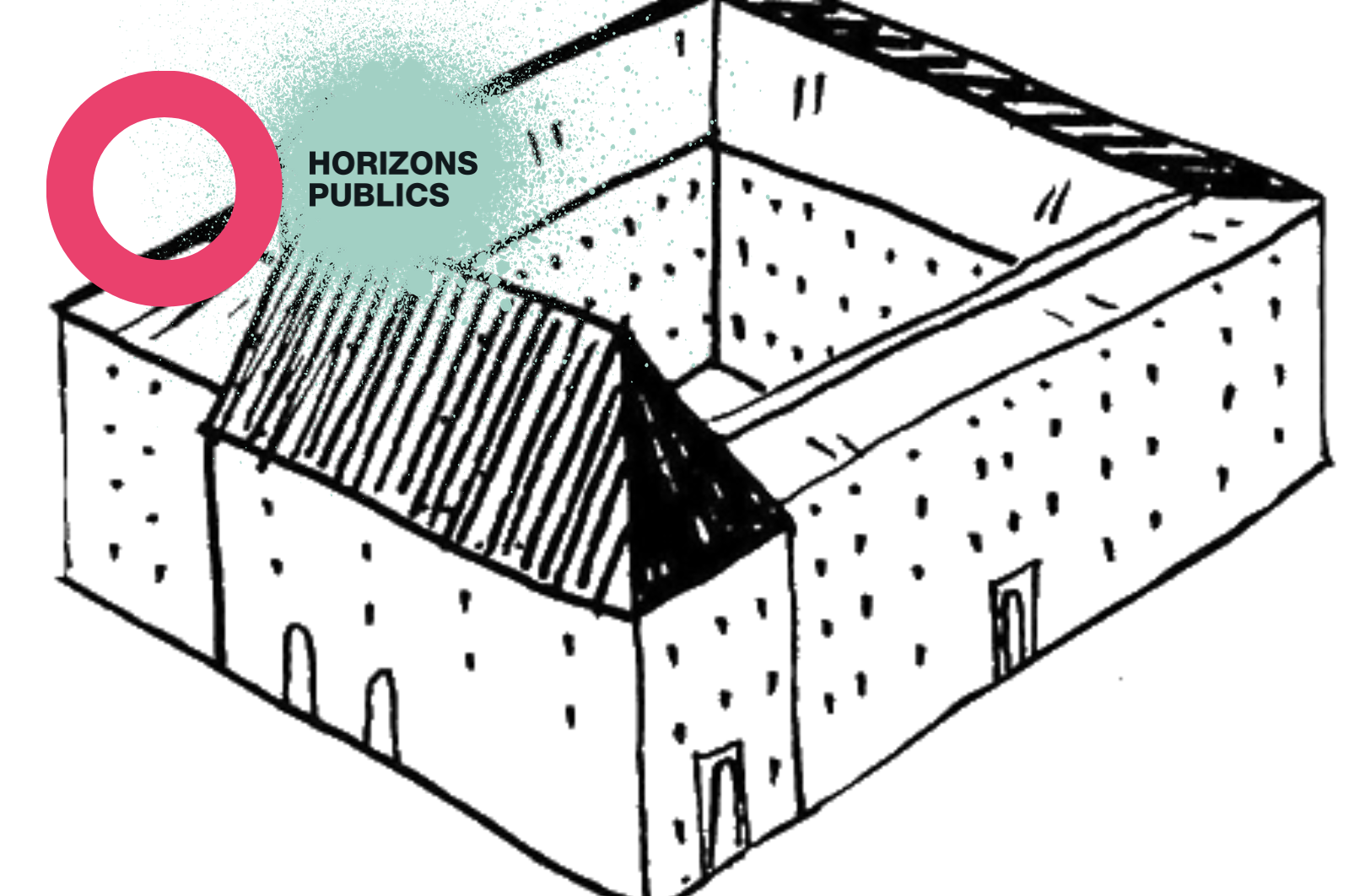Dans la commune de Billom, près de Clermont-Ferrand, un ancien collège jésuite, devenu tour à tour école militaire puis collège, avant d’être abandonné en 1994, a réouvert ses portes en 2019, sous l’impulsion de l’équipe communale, sous le nom de « La Perm ». Le site, situé au cœur de la ville, est devenu – sous l’élan du collectif d’architectes Rural combo, à qui la commune a confié une mission de préfiguration du projet, et en partenariat avec La preuve par 7 – un lieu de convivialité et d’initiatives locales. Entretien avec Jacques Fournier, à l’initiative du projet pour la commune de Billom, ancien adjoint à l’environnement, au patrimoine et à l’urbanisme et vice-président de la communauté de communes de Billom, aujourd’hui conseiller municipal délégué au patrimoine, pour décrypter le rôle de l’élu dans cette initiative.
Cet article a été produit dans le cadre du partenariat Média avec Horizons Publics. Cet article est republié à partir du site d’Horizons Publics. Lire l’article original.
Que trouve-t-on à La Perm aujourd’hui ?
Il se passe plein de choses que je n’arrive pas à suivre moi-même ! Les bénévoles font revivre ce lieu hautement symbolique pour la ville avec un marché de producteurs, des ateliers d’artisans, d’artistes, les Petits débrouillards, etc. Il y a des gens qui sont des utilisateurs réguliers, d’autres permanents, et ceux qui ne l’utilisent que ponctuellement, pour des événements particuliers avec notamment des concerts. Ça bouillonne, mais ce n’est pas ouvert tout le temps parce qu’il n’y a pas de salariés, que des bénévoles. Compte tenu du nombre d’habitants qui sont passés dans le collège dans le passé, ou de gens qui passent devant, il y a de l’intérêt, une espèce de curiosité. La Perm fait venir des gens nouveaux par rapport à la vie associative de Billom. Dans la ville, il y a 65 associations, dont certaines très actives. Or, ce sont des associations bien implantées dont certaines ont tendance à vieillir, ont peu de jeunes adhérents et ont du mal à renouveler leur gouvernance. La Perm amène, en termes de vie locale, une population différente et fait lien avec des associations historiques.
Comment est née la réflexion de la commune sur ce site ?
Compte tenu de la valeur symbolique du lieu, il y avait cet engagement politique de réouvrir les lieux, mais sans savoir comment. Nous avons commencé par faire l’état sanitaire du lieu et faire des travaux d’urgence de sécurisation. L’idée initiale était que le lieu était un patrimoine communal, excluant l’idée de le vendre ou de devoir le louer à des fins commerciales. Le Grand Clermont a financé une étude sur les usages potentiels du lieu dont les résultats ne nous ont pas forcément emballés : un catalogue avec une infinité de possibilités, avec des dispositifs à la mode comme le coworking ou les fablabs. L’intérêt de l’étude a été de chiffrer une facture de l’ordre de 25 millions d’euros. La commune étant seule à porter ce projet, il est très vite apparu que c’était complètement en dehors des clous. Cela ne nous intéressait pas de faire une inauguration dans quinze ans, une fois qu’on aurait pu mobiliser les fonds, faire des travaux, etc. L’idée que nous avons retenue est qu’il fallait ouvrir quand même. C’est dans ce contexte que j’ai rencontré Patrick Bouchain, avec qui nous avons visité l’ancien collège et qui a intégré le projet aux expérimentations de la Preuve par 7. Parallèlement, nous avons pris contact avec le collectif Rural combo qui venait de s’installer à 15 kilomètres d’ici, et qui était justement dans ce type d’approche. Toute la réflexion, l’argumentaire de Patrick Bouchain collait avec l’idée que je m’étais faite de la façon dont il fallait prendre les choses en main.
Quels ont été les freins en externe et en interne par rapport à cette démarche ?
Au lieu d’avoir un projet, de faire un programme, d’aller chercher des fonds, d’effectuer des travaux, et à la toute fin de penser à l’usage, nous avons décidé d’inverser la mécanique. Il n’y a pas que les experts qui peuvent faire des choses, mais aussi les citoyens et les élus, surtout dans un territoire semi-rural. L’idée qu’on ouvre un lieu sans programme n’était pas comprise par tous et toutes. Expliquer que ce sont les usages qui définissent le projet, c’est quelque chose, d’un point de vue culturel, qui est dur à assimiler. Ensuite, les contraintes liées au patrimoine ont été un frein supplémentaire.
Comment pérennise-t-on ces usages dans le temps ?
La mission que nous avons confiée à Rural combo est de nous aider à penser l’avenir. La commune ne finance pas La Perm, mais elle a financé la mission d’accompagnement. Et dès le départ, les principes ont été posés par la commune pour que le modèle économique qui se construit ne fonctionne pas avec des subventions publiques. Car, par expérience, quand les associations bouclent leur budget sur des financements publics, elles sont fragilisées au moindre coût de vent. D’autres questions se posent par rapport à la gouvernance et au modèle socio-économique. Comment mettre en place une gouvernance qui puisse résister au changement de personnes dans le temps ? Et comment avoir un modèle économique stable qui dans la durée ne crée pas une fragilité à terme ?
La Perm teste une organisation qui évolue dans le temps. Je suis estomaqué par l’énergie impressionnante qu’un certain nombre de personnes déploient. Il y a au moins une cinquantaine de personnes, des bénévoles actifs, qui se répartissent les missions régulièrement. Sur le modèle économique, je ne suis pas trop inquiet parce que pour l’instant ça tourne sans subvention publique. Les seules qu’ils ont obtenues ce sont des subventions qu’ils sont allés chercher eux-mêmes pour faire des travaux d’aménagement, mais pas pour le fonctionnement.
Quels ont été les apprentissages sur votre posture d’élu ?
La commune n’intervient pas directement pour diriger les choix qui sont faits. Il y a ainsi totale liberté au sein d’un cadre « système de valeurs » sur lequel on s’est accordé. Mais pour le reste, on n’intervient pas. Pour moi, la réussite est liée à ce choix : la commune n’intervient pas pour dire « il ne faut pas utiliser cette pièce, mais une autre » sauf si c’est une question de sécurité évidemment. Les décisions sont prises par trois types d’intervenants : les sachants, les élus (maîtres d’ouvrage) et les usagers. Pour que le projet fonctionne, il faut que ces trois composantes s’entendent à égalité. D’habitude, il y a toujours une hiérarchie qui s’établit : le sachant impose parce que c’est lui qui sait, pour l’élu, on est chez lui donc c’est à lui de décider… Pour résumer : ce sont les usagers qui savent quel peut être l’usage, et non l’expert.
L’élu doit être au service des autres, et non pas l’inverse. Et savoir faire confiance à la société civile.
Le défaut des élus c’est qu’ils sont persuadés que ce sont eux qui pensent, donc que c’est à eux d’impulser ce qu’ils pensent être bon pour la collectivité. Alors que pour moi, les élus sont plutôt des facilitateurs de projets, mais ce n’est pas eux qui doivent avoir « la bonne idée ». Le rôle d’élu est donc d’essayer de capter toutes bonnes énergies et de faire en sorte qu’elles s’épanouissent. L’élu est là pour faciliter et faire éclore toutes les potentialités… et c’est parce qu’il a un petit levier à disposition que n’ont pas les autres, pour prendre des décisions, pour mobiliser des fonds, pour médiatiser par rapport à l’ensemble des partenaires ou encore pour les faire se rencontrer. Il doit être au service des autres, et non pas l’inverse. Et savoir faire confiance à la société civile.
Pour résumer : ce sont les usagers qui savent quel peut être l’usage, et non l’expert.

Cet article est publié en Licence Ouverte 2.0 afin d’en favoriser l’essaimage et la mise en discussion.