Le mouvement des tiers-lieux vient interroger en profondeur le rôle de l’État – au sens large de l’ensemble des administrations et institutions publiques – en démontrant l’importance et l’efficacité de formes d’action collective d’intérêt général. L’essor du mouvement des tiers-lieux nous conduit à réinterroger la relation entre les administrations et la société civile, à questionner la place de la contribution citoyenne dans la fabrique de l’action publique.
Ce grand entretien avec Chloé Gaboriaux, docteure en sciences politiques, permet d’aborder ces questions fondamentales concernant le partage de l’intérêt général entre l’État et la société civile, à partir de l’examen historique de la reconnaissance d’utilité publique des associations en France entre 1870 et 1914 dans son ouvrage L’intérêt général en partage paru aux Presses de Sciences Po en 2023. Une période marquée par des transformations majeures dans les relations entre l’État républicain naissant et la société civile, qui remet en perspective des enjeux au cœur de l’actualité, notamment concernant la coopération entre l’État et la société civile. Le travail réalisé par Chloé Gaboriaux permet de mieux comprendre les choix de l’État républicain face aux défis sociaux du début du XXe siècle, et de mettre en lumière les mécanismes par lesquels l’État a tenté de maintenir le contrôle tout en déléguant des missions à des associations privées.
Ces travaux nous rappellent que la répartition des missions et des moyens nécessaires à l’accomplissement des actions d’intérêt général a évolué au fil du temps et reste un enjeu crucial. Le rapport entre l’État et la société civile, tout comme le rôle de l’État, ne sont pas statiques, ils se redéfinissent en fonction des contextes politiques, sociaux et économiques. Les organisations de la société civile, en particulier sous la forme des associations, ont historiquement occupé une place centrale dans la réponse aux besoins sociaux et la prise en charge de l’intérêt général, et cette dynamique perdure. Or, l’État apparaît, pour de nombreuses raisons (politiques, économiques mais également sociales et démocratiques), comme jouant un rôle déterminant dans la reconnaissance – ou non – de la place des organisations de la société civile, par exemple en légitimant l’action associative par le biais de la reconnaissance d’utilité publique, en mettant à disposition des moyens financiers ou encore en instituant des dispositifs juridiques et administratifs propices à leur épanouissement.
Cette analyse historique révèle une tendance persistante : la tension entre l’autonomie des initiatives citoyennes et le contrôle ou le soutien étatique. Ce débat trouve aujourd’hui une nouvelle résonance dans le cadre des politiques relatives aux tiers-lieux. Ces espaces d’innovation sociale incarnent les questions contemporaines d’articulation entre les initiatives citoyennes et l’action publique. La réflexion sur la juste répartition des rôles et des responsabilités entre l’État et la société civile, amorcée dans les débats de la fin du XIXe siècle, est donc plus actuelle que jamais.
Pour commencer, pourquoi avez-vous écrit ce livre ?
Chloé Gaboriaux : Pour deux raisons au moins. Premièrement, la République française, en devenant démocratique, a consacré le droit d’association. Je souhaitais reprendre à nouveaux frais la question essentielle que cela ouvre : la République reste-t-elle « jacobine » lorsqu’elle reconnaît la liberté d’association ? Quelles sont les implications philosophiques et politiques de la reconnaissance de l’utilité publique de certaines associations, notamment en ce qui concerne le partage de l’intérêt général entre l’État et des groupements intermédiaires ?
Deuxièmement, j’ai voulu analyser comment un État social peut se construire sans en avoir les moyens financiers. Cette réflexion est issue de discussions que j’ai pu avoir avec certains de mes étudiants, qui semblaient méconnaître ou sous-estimer la portée concrète du concept de solidarité à la fin du XIXe siècle, notamment dans le cadre des premières politiques sociales. À cette époque, la République, bien que portant des ambitions sociales et culturelles importantes, ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour les réaliser directement. Elle a ainsi dû s’appuyer sur les associations pour mener à bien ces politiques.
Ces deux questionnements se rejoignent dans une réflexion plus large : d’une part, sur la possibilité de partager la prise en charge de l’intérêt général dans un cadre républicain, et d’autre part, sur les mécanismes de construction de l’État social en l’absence de moyens suffisants, un enjeu crucial dès l’accession au pouvoir des républicains dans les années 1880.
Pour approfondir cette réflexion, j’ai choisi d’analyser les archives de la procédure de reconnaissance d’utilité publique des associations et fondations au Conseil d’État, un terrain peu exploré jusqu’à présent. Ces archives offrent une riche documentation sur le traitement des demandes venues des associations et fondations, étape ultime d’un processus dans lequel les ministères laissent le Conseil d’État valider ou non la reconnaissance d’une association ou d’une fondation comme établissement d’utilité publique. J’ai étudié entre 1 500 et 2 000 dossiers, qui contiennent à la fois les argumentaires des associations cherchant à prouver leur utilité publique et ceux du Conseil d’État, justifiant l’acceptation ou le refus de ces reconnaissances.
Mon analyse couvre la période allant de la proclamation de la République en 1870 jusqu’à 1914, avec un focus particulier sur la loi de 1901 qui marque un tournant dans la gestion des associations en France. Cette loi, en consacrant la liberté d’association, modifie profondément les modalités de reconnaissance d’utilité publique et soulève des questions sur la continuité et l’évolution des critères appliqués par le Conseil d’État avant et après son adoption.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l’État a recours à la reconnaissance d’utilité publique entre 1870 et 1914 ?
Chloé Gaboriaux : L’un des principaux enjeux pour le Conseil d’État face à une demande de reconnaissance d’utilité publique tient dans un certain nombre de risques potentiels : que le groupement devienne trop puissant, qu’il échappe au contrôle de l’État, qu’il fasse un mauvais usage des dons et legs qu’il pourrait recevoir ou encore qu’il rende au public un service défaillant voire trompeur. En 1870, la reconnaissance d’utilité publique (RUP) est en effet le seul moyen pour un groupement privé non lucratif d’obtenir la personnalité morale, lui permettant ainsi d’agir en tant que collectif, de posséder des biens et de signer des contrats en son propre nom. Avant 1901, sans cette reconnaissance, les associations ne peuvent pas exister juridiquement en tant qu’entités collectives. Cela pose de nombreuses difficultés pratiques, par exemple en cas de décès d’un membre clé d’un collectif, comme le trésorier qui, en l’absence de personne morale, détenait souvent en son nom les biens du collectif.
Le Conseil d’État s’appuie alors sur un avis rendu en 1805, dans lequel il exprimait déjà de fortes inquiétudes sur le fait que les associations qui œuvrent pour le bien public pourraient, en s’enrichissant, devenir des entités trop puissantes, agissant contre les intérêts de l’État ou mettant en danger les bénéficiaires de leurs services ainsi que les donateurs. Ce sont ces craintes qui le conduisent à maintenir la RUP, une procédure héritée de l’Ancien Régime, et qui conditionne l’obtention de la personnalité juridique et de la capacité à collecter des dons et legs à l’approbation du Conseil d’État, qui doit s’assurer qu’elles serviront l’intérêt général sans dévier de leurs engagements et missions.
La loi de 1901 apporte un changement significatif en permettant à toutes les associations d’accéder à une « petite » personnalité morale, réduisant ainsi l’importance de la reconnaissance d’utilité publique aux yeux des associations. Cependant, cette dernière reste cruciale pour les associations qui souhaitent recevoir des dons et legs, une source de financement importante à une époque où les subventions publiques sont relativement faibles.
Le Conseil d’État, devenu majoritairement républicain au début des années 1880, a ainsi un rôle clé dans l’organisation de ce qu’on appelle « l’État social » : dans un contexte où l’étroitesse du budget de l’État ne permet pas de le développement de services publics à la hauteur des ambitions républicaines, il oriente la générosité des particuliers vers des associations jugées suffisamment solides et dignes de confiance. Ce processus témoigne de la volonté de l’État de contrôler l’affectation des ressources publiques (au sens de collectives ou dédiées à l’intérêt général, quelle que soit leur origine), tout en reconnaissant la nécessité de soutenir des initiatives privées répondant à des besoins sociaux essentiels.
Comment expliquez-vous cette volonté de contrôle de l’État sur les associations ?
C.G. : À la fin du XIXe siècle, il s’agit moins d’identifier et promouvoir les initiatives privées d’intérêt général que de trouver un compromis entre la liberté d’association et les intérêts qu’elle pourrait remettre en question. La reconnaissance d’utilité publique est en premier lieu un outil qui permet aux associations de se développer et de se structurer sous la tutelle du Conseil d’État. Ce n’est que secondairement qu’elle consacre le partage de l’intérêt général, entre l’État, dont les ressources restent limitées, et les associations et fondations reconnues d’utilité publique, qui en appellent à la générosité des particuliers.
La loi de 1901 et la procédure de reconnaissance d’utilité publique subsistent aujourd’hui et il existe une grande continuité dans le fonctionnement des associations reconnues d’utilité publique, dont certaines existent depuis plus d’un siècle. Toutefois, les dispositifs législatifs se sont empilés au fil du temps, rendant le paysage juridique beaucoup plus complexe. Aujourd’hui, en plus de la reconnaissance d’utilité publique, il existe divers agréments, notamment fiscaux, ainsi que de nouveaux instruments comme par exemple le fonds de dotation. Cette complexité accrue multiplie les interactions entre le public et le privé. Deux tendances se dégagent aujourd’hui. D’une part, une délégation accrue des missions de l’État vers le secteur privé, souvent justifiée par un discours sur la nécessité de réduire la taille de l’État et de diminuer la dépense publique. D’autre part, une baisse des moyens étatiques – financiers et humains – permettant de contrôler les services publics assurés par le secteur privé.
La période que j’ai étudiée s’avère particulièrement intéressante pour comprendre et mettre en perspective cette question du contrôle étatique. L’État républicain du début du XXe siècle présente cette double caractéristique de ne pas pouvoir développer outre mesure les services publics, faute de financements, et de mettre en place un contrôle étatique fort sur les initiatives privées d’intérêt général, dans un contexte marqué par le conflit religieux et la présence de groupements antirépublicains.
L’idée qui domine alors le Conseil d’État républicain est que le secteur privé n’est pas capable de gérer correctement les biens publics, notamment en raison de l’éparpillement des dons et de l’étroitesse des ambitions privées, jugées inefficaces face aux grands défis sociaux, éducatifs et culturels. On voit combien cette perception contraste avec la croyance actuelle dans l’efficacité du privé sans contrôle ni régulation. Au tournant des XIXe et XXe siècles, on considérait au contraire que l’État devait contrôler, voire orienter les initiatives privées sans pour autant les nationaliser, faute de moyens.
Il est intéressant de noter que d’autres modèles existaient à l’époque. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, par exemple, la liberté d’association allait de pair avec l’accession à la personnalité morale, au moins partiellement, sans passer par une procédure aussi centralisée que celle de la reconnaissance d’utilité publique en France. Certains juristes français proposaient d’ailleurs de se rallier à ce modèle, en offrant aux associations non seulement la liberté de se constituer mais aussi celle d’acquérir la personnalité morale et de recevoir des dons et legs, tout en laissant les tribunaux traiter les litiges qui pourraient survenir. Le Conseil d’État, comme le législateur d’ailleurs, s’y est constamment opposé, au nom de la protection des intérêts de tous ceux qui ne pourraient pas les faire valoir devant un tribunal : les personnes vulnérables bénéficiaires des soins des associations ou les donateurs leur ayant confié leur argent. La crainte est aussi que les malversations des associations ou fondations rejaillissent sur l’État lui-même, mis en cause dans sa capacité à garantir l’ordre public et les droits de ses citoyens. Ainsi, la centralisation et le contrôle étatique étaient perçus comme des moyens de protéger la République et de maintenir la confiance des citoyens entre eux et vis-à-vis de l’État.
Cette divergence de vue par rapport au modèle britannique, qui mise au contraire sur la pression de l’opinion publique pour réguler les associations, est révélatrice des différences culturelles entre nos pays. En France, l’idée prédominante était au contraire que tout scandale finirait par remettre en question le crédit de l’État, d’où la nécessité d’un contrôle préventif. Cette perception reste d’actualité, avec une tendance française à invoquer la responsabilité de l’État quand des acteurs privés commettent des abus.
En limitant le nombre d’organisations pouvant recueillir des dons et répondre à des besoins sociaux, l’État se positionnait donc clairement – c’est très présent dans les avis du Conseil d’État – à la fois comme organisateur des services publics assurés par le secteur privé et comme protecteur des intérêts des individus incapables de se défendre par eux-mêmes, affirmant ainsi son rôle de garant de la justice sociale.
Quels sont les liens entre les services publics et le développement de la reconnaissance d’utilité publique ?
C.G. : L’étude des relations entre l’État et les associations d’utilité publique à la fin du XIXe siècle révèle une interaction étroite entre le concept ancien d’utilité publique et le concept émergent de service public. Jusque dans les années 1890, le Conseil d’État confond les deux termes : il tend à appliquer aux associations reconnues d’utilité publique les mêmes exigences qu’aux établissements publics, notamment en termes de gratuité et de laïcité, deux principes qui allaient devenir les fondements du service public. À partir des années 1890, une évolution notable se produit : le Conseil d’État commence à reconnaître que les associations relèvent du secteur privé et qu’elles peuvent donc définir l’intérêt général selon leurs propres critères, y compris en réservant leurs services à des catégories particulières de la population. Cette évolution a suscité des débats et des conflits au sein du Conseil d’État, les plus républicains de ses membres étant à la fois hostiles à l’idée que les associations d’utilité publique puissent se soustraire aux principes du service public et convaincus qu’elles relevaient de la sphère privée et devaient à ce titre rester autonomes dans leurs activités.
L’un des enjeux de cette période réside dans la répartition des services publics entre l’État, le département, la commune, les établissements publics et les associations et fondations. Le Conseil d’État ne se prononce pas en fonction de la nature des services publics, mais en s’appuyant sur les priorités politiques de la République, définies par les gouvernements successifs. Par exemple, l’éducation a progressivement été intégrée dans la sphère du service public, en tant que priorité politique républicaine, tandis que d’autres domaines, comme le soin aux personnes âgées, étaient en grande partie laissés au secteur privé non lucratif.
Ce processus décisionnel révèle une conception de la subsidiarité où le privé intervient lorsque le public ne peut ou ne souhaite pas assurer certaines missions. Ainsi, certaines œuvres reconnues comme utiles à la population, comme l’accueil des orphelins, pouvaient être confiées soit à des associations, soit à des établissements publics, soit à des services municipaux ou départementaux, selon les priorités du moment. Le Conseil d’État jouait un rôle crucial dans ce « classement » des missions, en s’appuyant sur des critères politiques pour déterminer ce qui devait être reconnu d’utilité publique, c’est-à-dire laissé aux mains des associations.
L’exemple des caisses des écoles illustre bien ce processus. Ces associations, initialement privées, avaient pour but d’encourager la scolarisation des enfants en finançant leurs besoins matériels. Toutefois, lorsque le gouvernement républicain a défini cette mission comme une priorité pour l’État, ces dernières sont devenues un service public et sont donc passées du privé au public.
Il est intéressant de noter que le Conseil d’État, tout en présentant son rôle comme technique, jouait parfois un rôle véritablement politique. Entre 1880 et 1914, il refuse notamment de reconnaître certaines associations coopératives ou féministes, alors même qu’elles avaient le soutien des gouvernements républicains plus progressistes. Ces décisions montrent que le Conseil d’État ne faisait pas que vérifier la conformité à la loi des projets de reconnaissance d’utilité publique qui lui étaient présentés par les gouvernements. Il pouvait également exercer une influence – en l’occurrence conservatrice – sur la définition de ce qui relève de l’utilité publique.
En résumé, l’évolution des critères de reconnaissance d’utilité publique par le Conseil d’État au tournant du XIXe siècle reflète les tensions entre l’essor du service public (de l’État, des départements et des communes) et la reconnaissance du rôle croissant des associations privées dans la sphère de l’intérêt général. Cette période marque un moment clé dans la définition des contours du service public en France, influencée par des choix politiques qui ont façonné la répartition des responsabilités entre le public et le privé.
Constatez-vous une évolution des partenariats entre l’État et la société civile ?
C.G. : Aujourd’hui, le débat public autour des initiatives d’intérêt général, notamment dans le cadre des tiers-lieux, des communs ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, met en lumière des structures co-gouvernées par l’État et la société civile. Bien que ces formes de coopération puissent sembler nouvelles, elles trouvent leurs racines dans des pratiques plus anciennes, comme je l’ai montré pour la fin du XIXe siècle. À cette époque, bien que les termes de « co-construction » ou « co-production » des politiques publiques n’étaient pas employés, des dispositifs de collaboration entre le privé et le public existaient déjà. Par exemple, les conseils supérieurs instaurés par les républicains à la fin du XIXe siècle incluaient des représentants de la société civile pour participer à l’élaboration de politiques publiques dans des domaines tels que la prison ou l’enfance.
Ces politiques étaient ensuite mises en œuvre conjointement par l’État, les départements, les communes, les établissements publics et les associations d’utilité publique. Le Conseil d’État jouait un rôle crucial en s’assurant que ces différentes entités ne se livrent pas à une concurrence préjudiciable. Il pouvait ainsi refuser la reconnaissance d’utilité publique à certaines associations pour des raisons conjoncturelles, par exemple lorsque leur action risquait de compliquer la mise en place d’un service public ayant le même objet. Toutefois, une fois le service public bien établi, la reconnaissance d’utilité publique pouvait être accordée à ces associations. Il s’agissait donc déjà, même si le terme n’était pas utilisé, d’une forme de co-construction et de subsidiarité, où chaque acteur était appelé à jouer un rôle complémentaire.
Aujourd’hui certains estiment que le soutien de l’État pour les tiers-lieux est synonyme de contrôle, est-ce que cela fait écho à ce que vous avez observé à la fin du XIXe siècle ?
C.G. : Ce que montre le cas des associations et fondations reconnues d’utilité publique à la fin du XIXe siècle, c’est que le contrôle ne passe pas seulement par le soutien, notamment financier, mais aussi par les statuts juridiques offerts aux groupements privés. À travers eux, l’État impose ses normes à l’activité privée, et notamment les conditions dans lesquelles elle peut solliciter des financements publics ou privés.
Aujourd’hui encore, même si les modalités de contrôle ont évolué, il est difficile pour une entreprise ou une association de développer une activité d’intérêt général sans entrer en relation avec les entités publiques.
« Le débat public semble aujourd’hui enfermé dans une opposition binaire entre nationalisation et privatisation, occultant souvent le rôle des associations et plus largement de la société civile, dans la production de l’intérêt général. Il est frappant de constater que les corps intermédiaires, tels que les associations et les syndicats, ont été de plus en plus marginalisés au cours des dernières décennies. »
Ce que l’on observe également à la fin du XIXe siècle, et que l’on a souvent tendance à oublier lorsqu’on critique le contrôle étatique, c’est la forte conscience que toute action collective sur le territoire national produit des externalités, tantôt positives, tantôt négatives, que l’État républicain se donne pour mission de réguler. Dès lors, il semble difficile de concevoir une action collective qui se ferait au nom de l’intérêt général sans la présence d’un arbitre capable de protéger les intérêts de ceux qui pourraient se sentir lésés par ces actions. Dans une société aux intérêts diversifiés comme la nôtre, le développement des initiatives privées conduit régulièrement les individus ou les groupes à se tourner vers l’État pour qu’il protège leurs droits et leurs intérêts.
Comparée à la période que j’ai étudiée, l’administration publique aujourd’hui est beaucoup plus développée, avec une capacité accrue à identifier et répondre aux besoins sociaux grâce à des moyens humains et financiers renforcés. Toutefois, le débat public semble aujourd’hui enfermé dans une opposition binaire entre nationalisation et privatisation, occultant souvent le rôle des associations et plus largement de la société civile, dans la production de l’intérêt général. Il est frappant de constater que les corps intermédiaires, tels que les associations et les syndicats, ont été de plus en plus marginalisés au cours des dernières décennies.
Or, la construction de l’« État social » a été une entreprise collective, impliquant non seulement l’État, mais aussi la société civile – les mutuelles, les syndicats et diverses associations, toutes contribuant à la mise en place d’un système de solidarité nationale. La Sécurité Sociale en est sans doute le plus bel exemple. Il me semble aujourd’hui essentiel de rouvrir la réflexion sur les formes de partenariats équilibrés entre l’État et la société civile : simplification des procédures de reconnaissance d’utilité publique ? Plus grande transparence dans les processus de décision, permettant de maintenir la confiance des citoyens dans l’État comme dans les associations impliquées ? Renforcement des corps intermédiaires, tels que les syndicats et les mutuelles, pour qu’ils jouent un rôle plus actif dans la gouvernance des services publics, dans une logique de complémentarité et non de substitution ? Les réformes du droit et de la structure de l’État restent à imaginer pour faciliter une plus grande implication de la société civile dans la production d’activités d’intérêt général, sans favoritisme ni détournement des ressources publiques par certains acteurs privés.
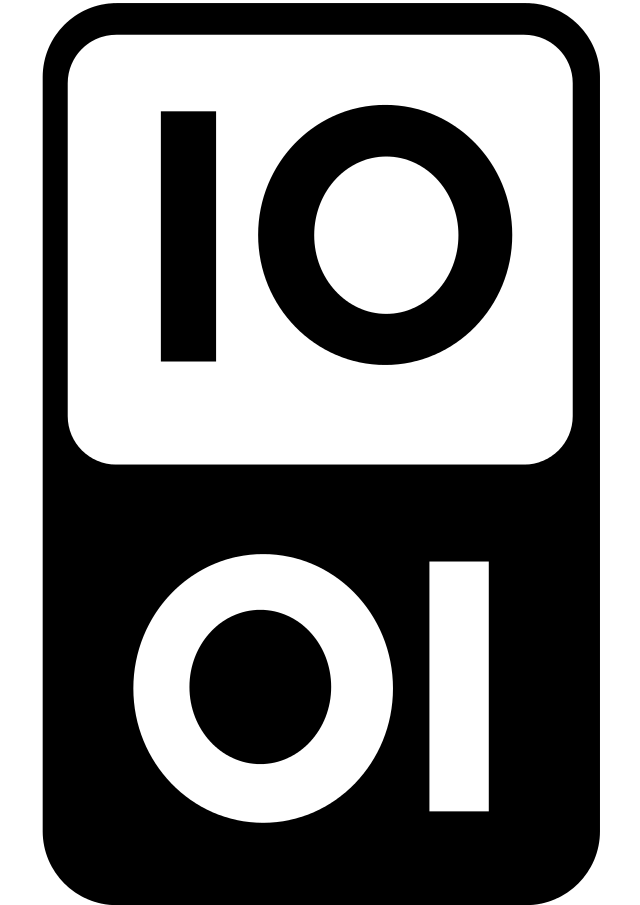
Cet article est publié en Licence Ouverte 2.0 afin d’en favoriser l’essaimage et la mise en discussion.
