Quelle place pour les tiers-lieux dans la bataille autour d’une société plus sobre qui agite une partie des institutions françaises ? Les tiers-lieux doivent-ils être des néo-services publics, voir des lieux où se massifie le recours à la réparation ? Ou au contraire devenir des contre-pouvoirs générateurs d’une culture et d’une autre façon de faire société, à même de faire émerger des décisions politiques de grande ampleur ?
« Le dérèglement climatique nous impose des choix de société. Si nous voulons mener notre transition écologique tout en préservant notre prospérité et nos libertés, nous n’avons pas d’autre choix que d’aller vers plus de sobriété dans notre façon de consommer et de trouver un chemin vers une économie plus circulaire, c’est-à-dire une économie qui réutilise davantage les ressources au lieu de les extraire, de les utiliser et de les jeter. » C’est par ces mots que Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, appelait de ses vœux un « Green Friday » dans une tribune parue dans le journal Le Monde en réponse au « Black Friday« , cette grande fête de la consommation inspirée des États-Unis qui pose de plus en plus de questions à l’heure des limites climatiques.
L’heure à la prise de conscience ?
Les mots du ministre s’inscrivent dans ce qui ressemble à la fois à une prise de conscience et à une offensive d’une partie des politiques publiques autour de la question de la réparation des objets, et, au-delà, des changements dans les modes de consommation des Français : campagne de publicités de l’Ademe autour du concept de « dévendeurs » pour inciter à réparer plutôt qu’acheter, inscription de l’indice de la réparabilité sur certains objets électroménagers dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) en 2021, « bonus réparation » permettant d’obtenir 20% de réduction sur des produits électroniques ou textiles que l’on emmène réparer depuis 2022, etc.
Des mesures à mettre en perspective avec les transformations de la société française depuis les Trente Glorieuses. En moyenne, chaque foyer français possède 2,5 tonnes de biens, nécessitant l’extraction de 45 tonnes de matières premières. La fabrication d’un lave-vaisselle nécessite à lui seul d’excaver plus de 2 tonnes de matériaux (Ademe 2018). Quelque 40 millions d’objets tombent en panne chaque année et ne sont pas réparés, faute d’une garantie suffisante et devant le prix des réparations (« Allongement de la durée de vie des objets », Ademe 2016). Des statistiques que l’on pourrait égrener à l’infini. En bref, selon un rapport de l‘ONG Global Footprint Network, plus de 2,9 planètes seraient nécessaires pour répondre aux seuls besoins de la population française.
On ne peut manquer de relier les mesures fortes prises par les institutions avec la structuration tout aussi forte de la société civile sur ces sujets ; ce que les premières Journées nationales de la réparation d’octobre 2023 ont su capter et rassembler. Cette initiative de l’association Halte à l’obsolescence programmée (Hop) et du fond de dotation make.org ressemblait d’ailleurs à s’y méprendre à une première expérimentation grandeur nature de ce à quoi pourrait ressembler un “Green Friday” : plus de 1300 événements à travers la France soutenus par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, permettant de visibiliser tous les acteurs du secteur du réemploi et de la réparation pour “faire de la réparation une habitude simple et ancrée dans le quotidien de toutes et tous, ainsi qu’une exigence environnementale incontournable”.
De la conscientisation au Faire, un parcours semé d’embûches
Toutefois, un paradoxe traversait ces journées : bien que 81% des Français plébiscitent actuellement l’idée de la réparation, seuls 33% la mettent effectivement en œuvre. Plus préoccupant encore, l’exemple du tollé suscité par la publicité des “dévendeurs” jusqu’au ministre de l’économie Bruno Le Maire, qui l’a jugée “maladroite”, et les appels à son “retrait pur et simple” de la part de l’Alliance du Commerce, de l’Union des Industries Textiles (UIT) et de l’Union française des Industries de la Mode et de l’Habillement (UFIMH). Des réactions qui laissent songeur quant à l’ampleur du changement culturel à entreprendre et aux intérêts socio-économiques à combattre.
Peut-on d’ailleurs réellement espérer “réinstaller une culture de la sobriété, de la réparation et du réemploi” dans l’ensemble d’une société, pour paraphraser Christophe Béchu, sans s’assurer d’une mobilisation populaire et d’une pression politique provenant d’une large part de cette même société ?
Pour Hop et Make.org, cette grande transformation sociétale ne pourra se faire sans “la multiplication des initiatives citoyennes dans les repairs cafés, les fablabs, les tiers-lieux, les associations de quartier, ou encore les ressourceries et recycleries”. Alors, si un consensus semble se dégager par l’ensemble des acteurs institutionnels, privés et issus de la société civile, autour de l’avènement d’une société plus écologique dont la pierre angulaire serait la réparation – ce que les auteurs Jérôme Denis et David Pointille nomment l’avènement d’une “politique de la maintenance” Jérôme Denis, David Pontille, Le soin des choses. Politiques de la maintenance, Paris, La Découverte, coll. « Terrains philosophiques », 2022, 368 p. –, reste à s’accorder sur comment mettre en place ces politiques et dans quelle vision de société les inscrire. »
Des désaccords que résume Catherine Mechkour Di Maria, secrétaire générale du réseau des ressourceries et recycleries, intervenante lors des journées de la réparation : “dans nos dialogues avec les pouvoirs publics autour du réemploi, le mot d’ordre de ces derniers est clair : l’heure est à la « massification ». Mais comment mettre en marche cette « massification » ? Peut-on raisonnablement penser que prendre pour cadre de pensée le modèle industriel productiviste, dans l’espoir d’en corriger les conséquences désastreuses, nous mènera ailleurs que dans une impasse ?”
Alors, quel(s) rôle(s) donner aux initiatives citoyennes qui traversent le mouvement tiers-lieux, du repair café au fablab, en passant par les ressourceries et recycleries ? Un rôle de néo-services publics ou bien un rôle de prototypage d’une société post-consommation ? Dans le premier cas, le résultat serait sans doute une massification d’une politique industrielle de la réparation, avec le risque de ne jamais remettre en question les conditions systémiques de surconsommation et les modes de production. Dans le second cas, les tiers-lieux pourraient mettre en œuvre concrètement et politiquement un nouvel âge de la maintenance, porteur d’une vision de société post-industrielle et post-consommation dont ils se revendiquent, sans pour autant se leurrer sur le temps long et la radicalité qu’impliquerait une telle mise en œuvre.
Avant de pencher réellement vers l’un ou l’autre de ces rôles, encore faut-il comprendre l’ADN historique inscrit dans une partie d’entre eux : celui des utopies d’Internet.
De la contre-société numérique à la contre-société écologique, un cheminement naturel pour les tiers-lieux ?
Dans la première thèse de référence sur le sujet, Antoine Burret écrit que c’est “la démocratisation des nouvelles technologies dans les années 2000 qui contribue à l’émergence de nouvelles formes d’espaces publics, nommés tiers-lieux. Antoine Burret, Tiers-lieux…. et plus si affinités, Limoge, Fyp Editions ; 2015, 175p. Ces tiers-lieux ne sont pas unidimensionnels et regroupent déjà des réalités aussi diverses que des “coworking spaces” (espaces de travail collaboratifs), des “fablabs” (laboratoires de fabrication), des “techshops” (espaces rendant accessibles tout un ensemble d’outils) ou encore des “hackerspaces” (espaces permettant le partage de ressources et de savoirs souvent du domaine de l’informatique).
Si l’on part des exemples du fablab et du hackerspace, tous deux reposent sur l’idéologie du makers qui promeut la bidouille et le DIY (Do It Yourself), un mode de vie où le faire soi-même, avec ses mains, est à nouveau au cœur de l’existence. Dans cette culture, tout est invitation à redonner du sens aux activités de bricolage et de production à son échelle, en dehors des cadres établis (entreprises, administration, etc.) tout en documentant en open source pour que d’autres membres de la communauté, parfois situés à l’autre bout de la planète, puissent s’approprier la connaissance créée. Le hackerspace va encore plus loin en promouvant l’idée du hack, qui invite à pirater la propriété des objets, à les détourner pour mieux se les approprier et les rendre accessibles au plus grand nombre.
Pour les chercheur.e.s Isabelle Berrebi-Hoffmann, Marie-Christine Bureau et Michel Lallement, dans leur livre Makers. Enquête sur les laboratoires du changement social Isabelle Berrebi-Hoffmann, Marie-Christine Bureau et Michel Lallement, Makers. Enquête sur les laboratoires du changement social, Le Seuil, Paris, 2018, 352 p, le mouvement makers est “à l’origine d’un mouvement culturel de transformation, par la pratique, des manières de faire, de produire, de consommer et d’apprendre. En expérimentant des formes inédites de fabrication par soi-même des biens de consommation, inspirées par un principe de libre accès aux outils et aux savoirs, ils ambitionnent souvent, en opposition avec notre ancienne société industrielle, de transformer leur environnement, leur vie quotidienne, voire la société tout entière.”
Une culture fertile sur laquelle de nombreux tiers-lieux se sont appuyés pour s’engager entièrement dans une perspective de contribution à la transition écologique de leurs territoires. C’est notamment le cas de l’Hermitage, tiers-lieu emblématique de la Picardie depuis 2017, reconnu à l’échelle nationale comme chef de file de ces nouveaux lieux autour de l’écologie. La communauté historique de l’Hermitage était constituée globalement de toutes les nuances d’acteurs issus du numérique, du hacker citoyen Gaël Musquet, à la Rurale Hacking Factory pilotée par Stéphanie Lewis, en passant par Jean Karinthi ancien responsable de la Maison des associations du 11ème arrondissement de Paris, au conseil d’administration d’OpenStreetMap pendant 5 ans. Un collectif qui était de leurs propres aveux “plutôt éloignés des grands enjeux écologiques globaux et systémiques”, et avaient clairement un ADN “très branché numérique”. Le fablab et la Rurale Hacking Factory ont laissé place, au fil du temps, à des activités de plus en plus tournées uniquement vers la transition écologique, jusqu’à se définir aujourd’hui comme un “démonstrateur des transitions au dernier kilomètre”.
Autre cas concret, celui de La Smalah, tiers-lieu situé dans les Landes à Saint-Julien-en-Born. Ouvert en 2015 autour d’un café associatif, ce tiers-lieu proposait principalement à ses débuts des activités de médiation numérique et d’éducation aux médias. Le collectif derrière le projet lancera par ailleurs, et pendant un an, en 2018, une formation labellisée « Grande école du numérique » afin de devenir médiateur numérique. En 2019, les équipes de La Smalah s’associent avec celles du Grenier de Mézos, une recyclerie locale, pour ouvrir un fablab collaboratif à même de fabriquer objets et mobiliers issus des “200 tonnes de matériaux récupérées chaque année”. Une association relativement rare à l’échelle nationale pour être soulignée. Ce processus d’hybridation des activités et des lieux autour de la réparation et du réemploi est cependant loin d’être anodin, et témoigne plutôt une tendance de fonds parmi le mouvement des tiers-lieux.
Vers une “tiers-lieu-isation” des recycleries et ressourceries
En 2023, 216 ressourceries et recycleries adhéraient au Réseau national des Ressourceries et Recycleries (RNRR). Elles n’étaient que 172 en 2021, et 146 en 2019. Une évolution constante qui ne prend pourtant pas en compte toutes celles qui ne font pas partie du réseau. Pourquoi un tel engouement ? Pour le comprendre, revenons aux origines de ces lieux articulés autour des “3R : réduire, réemployer/réutiliser, recycler”. Le terme « recyclerie » est utilisé pour la première fois au début des années 1990 aux Ateliers de la Bergerette, avant d’être repris par l’ensemble des acteurs français dans les années 1990. Le terme « ressourcerie », quant à lui, vient du Québec et voit le jour la même décennie. Les deux termes sont déposés au cours des années 2000 par le RNRR, et prennent leurs essors au cours de la décennie suivante, sous le double effet de la professionnalisation du secteur des déchets, et de la délégation de service public qui voit les collectivités territoriales s’appuyer massivement sur le secteur associatif pour réduire et réemployer leurs déchets. Rassat F. 2017, Consommer local et s’inscrire dans un territoire. Les pratiques de réemploi et d’achat en ressourcerie , Terrains & travaux, vol. 2, n° 31, p. 87-108 – https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2017-2-page-87.htm
Qu’appelle-t-on ressourcerie, et quelle différence avec les recycleries ? Pour Catherine Mechkour Di Maria “une recyclerie est un lieu qui va se spécialiser dans le réemploi d’un flux de déchets, issu du don : des jouets, des livres, du textile, etc.” A contrario, “une ressourcerie est un lieu généraliste qui collecte tous types de flux de déchets, et qui possède quatre fonctions principales : la collecte, la valorisation (tri, nettoyage, réparation), la redistribution (vente ou don), et la sensibilisation des citoyens. Dans le mouvement, ces petits ouvriers et ouvrières essaient de fabriquer concrètement des alternatives au modèle de consommation dominant.” Ces lieux sont majoritairement portés par des personnes provenant des milieux de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Beaucoup de ressourceries et recycleries possèdent dans leurs ADN l’emploi de celles et ceux qui sont les plus fragiles et éloignés de l’emploi.
Si cet ancrage historique dans l’écologie, par le fait de faire émerger une vision de société autour de la question du déchet et d’une société de post-consommation et de “réparer autant les hommes que les objets”, marque un point différenciant avec une partie du réseau des tiers-lieux, on assiste depuis quelques années à un phénomène de “tiers-lieu-risation” accélérée d’une partie des membres des ressourceries et recycleries, sans doute poussés par la nécessité de suivre les phénomènes de mode institutionnels qui permettent d’obtenir des subventions – à l’instar du réseau des Foyers familles rurales qui a massivement positionné ses lieux comme des “tiers-lieux” depuis 2020 Site web, familles rurales tiers-lieux,https://tiers-lieux.famillesrurales.org/7/la-vision-familles-rurales . Mais s’inscrire dans ce phénomène permet aussi à ces acteurs et mouvements historiques de revenir sur le devant de la scène et d’être à nouveau considérés par les acteurs institutionnels non pas comme “le passé”, mais comme “le futur”.
Symbole de ces hybridations, la Mine, un espace dédié au réemploi et à l’insertion par le travail situé à Arcueil. La Mine se définit à la fois comme tiers-lieu et comme une ressourcerie, dépassant ce qui caractérise à la base une ressourcerie, soit le fait de donner une “seconde vie” aux objets, luttant ainsi contre “l’accumulation des déchets”, et s’articulant autour de la philosophie des « 3R (réduire, réemployer/réutiliser, recycler) ».La Mine rassemble en un même espace un café associatif, une crêperie, des ateliers de revalorisation des objets, un fablab ou encore un atelier de réparation de vélo. Des activités qui, reliées à de nombreuses communautés, permettent de faire tiers-lieu, de proposer selon les termes de Régis Pio, co-fondateur, “un projet politique, pas au sens partisan du terme, mais un projet politique de mise en mouvement, d’émancipation des parties prenantes autour de la valorisation des déchets” Hyperliens, La Mine, bien plus qu’une ressourcerie, https://youtu.be/5wXlSBw1Mu4?si=ghpcT_Kac7haarx3. Un lieu où s’expérimente aussi d’autres modes de consommation, basées sur le don contre don, que l’on agrémente d’ateliers où l’on apprend à ”réparer son grille-pain comme un acte de résistance à la société” de consommation, tout en permettant l’accès à un réemploi de proximité. Tout un continuum de pratiques qui sont autant de façons de s’engager localement à son échelle, autour de l’écologie. Rassat F. 2017, Consommer local et s’inscrire dans un territoire. Les pratiques de réemploi et d’achat en ressourcerie , Terrains & travaux, vol. 2, n° 31, p. 87-108, https://doi.org/10.3917/tt.031.0087
Quitter le techno-solutionnisme, entrer dans l’ère du “réoutillage convivial”
Aujourd’hui quand une agence d’état comme l’Ademe ou le ministère de la Transition écologique évoquent leurs engagement auprès des tiers-lieux, ces “pivots de la transition écologique sur les territoires”, ils expliquent vouloir “encourager les expérimentations et les solutions innovantes qui se déploient à travers les tiers-lieux : rénovation énergétique, réemploi et recyclage, alimentation durable, mobilité…” Communiqué de presse Ademe, ministère de la transition, Agence Nationale de la cohésion des territoires, https://presse.ademe.fr/2022/03/le-ministere-de-la-transition-ecologique-et-lademe-sengagent-aux-cotes-de-france-tiers-lieux-pour-faire-des-tiers-lieux-les-pivots-de-la-transition-ecologique-dans-les-territoires.html
Nulle part n’est faite mention des projets de société contenus dans ces lieux, des systèmes de pensée sur lesquels ces micro-sociétés fondent une partie de leurs actions. Un impensé pour Catherine Mechkour Di Maria : “bien évidemment, il sera toujours nécessaire de discuter autour de la réparation des cafetières, mais étant donné la gravité du sujet, nous sommes dans l’obligation de replacer ces micro-actions dans une réflexion plus globale. Le projet de société dans lequel nous vivons actuellement, que nous savons mortifère, est celui de la « société de consommation ». Il nous faut changer de projet de société.”
Ce projet de société, quel est-il ? Compte tenu de la grande diversité des tiers-lieux, il semble impossible de réduire l’ensemble du mouvement à une seule idée. Néanmoins, dans le cadre de leur contribution au développement d’une société de la réparation, il est possible d’en identifier deux.
Le premier, l’hypothèse bio-régionaliste, que déploie Kirkpatrick Sale dans son livre “l’art d’habiter la terre”, et qui interroge le triptyque État-nation, science et capitalisme afin de réinscrire l’humain dans la biosphère. Elle remet au cœur de l’équation la question de l’échelle, en se recentrant sur les questions d’auto-suffisance au niveau de la communauté et du local. Kirkpatrick Sale, l’art d’habiter la terre, la vision biorégionale, Wildproject, Paris, 2020, 340p. Pour la journaliste Chrystèle Bazin, malgré les limites de cette pensée, c’est une façon de saisir le mouvement de ces tiers-lieux qui “agissent déjà comme des laboratoires biorégionalistes”, en “expérimentant des modes d’habitats anthropocènes, c’est-à-dire en accord avec les principes écologiques décrits par Sale, et en recréant des dynamiques collectives de proximité”. Chrystèle Bazin, 2023, L’art de (ré)habiter la terre, observatoire des tiers-lieux, https://observatoire.francetierslieux.fr/lart-de-rehabiter-la-terre/
Le second courant a directement à voir avec l’utopie makers citée précédemment, et l’un des pères de la pensée écologique en France. Ivan Illich, connu pour sa critique de la société industrielle et capitaliste, raconte dans son ouvrage La Convivialité que « dans le système actuel d’usure programmée à grande échelle, quelques centres de décision imposent l’innovation à l’ensemble de la société et privent les communautés de base de choisir leurs lendemains ». Ivan illich, la Convivialité, lepoint, 2021, 176 p. Il appelle de ses vœux un “outillage convivial”, qui permet de répondre à ses besoins essentiels à son échelle, un “outil” dont chacun puisse se servir “sans difficulté”, et sans “besoin de diplôme pour avoir le droit de s’en servir”..
Ces deux systèmes de pensée semblent antagonistes d’une partie des politiques publiques, notamment celles actuellement traversées par les imaginaires techno-solutionnistes de la Silicon Valley américaine. Imaginaires que le journaliste Evgeny V. Morozov, dans son ouvrage Pour tout résoudre cliquez ici, l’aberration du solutionnisme technologique Evgeny V. Morozov, Pour tout résoudre, cliquez ici : l’aberration du solutionnisme technologique, FYP éditions, 2014, résume comme ce courant de pensée qui voudrait faire “d’internet et des nouvelles technologies” la solution à toutes les grandes problématiques mondiales : de la faim dans le monde, aux problématiques de ressources en eau, en passant par l’émission de carbone dans l’atmosphère. La croyance dans l’innovation et le marché tenant souvent lieu de solutions à des questions qui reposent avant tout sur des questions d’ordres sociales ou politiques.
Or, pour Catherine Mechkour Di Maria, “actuellement, dans le contexte de la crise écologique, parier uniquement sur la technologie comme solution est une approche risquée. Ignorer la société civile qui est en train de se mobiliser et d’inventer la société de demain à partir de démarches locales vertueuses me paraît irrationnel. Nous plaidons pour un investissement massif dans ces initiatives, plutôt que de concentrer les fonds sur le monde des start-ups”.
Massification VS archipélisation, les politiques publiques à l’heure des choix
Le mariage est-il impossible entre institutions publiques et mouvement des tiers-lieux ? Non, à condition de sortir de sortir de l’ambiguïté et de l’indécision qui met au même niveau des acteurs du capitalisme de la seconde main, comme Black Market ou Vinted, avec des acteurs partisans d’une décroissance et d’une société de post-consommation comme Emmaüs ou le Réseau des ressourceries.
Un choix de société sur lequel décideurs politiques et législateurs se devront de trancher, et que nous expose Catherine Mechkour Di Maria : “concernant la question du réemploi qui nous occupe, c’est aller vers des modèles de circuits courts comme ceux que nous expérimentons avec nos lieux, et acter que les modèles de réemploi autour de grandes plateformes cherchant à « massifier » la gestion des déchets, avec des robots, des camions, etc., ne sont pas cohérents avec le carbone que l’on doit arrêter de rejeter dans l’atmosphère.”
Une sortie de l’ambiguïté qui s’exerce aussi autour des notions-clefs d’un passage à l’échelle concernant la filière du réemploi et des déchets, et des méthodes pour y parvenir. Là où une grande part des institutions publiques rêvent de massification, de pouvoir modéliser et reproduire les tiers-lieux ayant fait leurs preuves afin de mailler le territoire, ces derniers répondent souvent d’une façon critique, par la non-reproductibilité de leur modèle, l’adaptation à chaque contexte, la déclinaison en fonction de chaque communauté et espaces géographiques. Pour Catherine Mechkour, “le désaccord avec le concept de passage à l’échelle, réside dans la façon dont il est généralement envisagé, d’une façon très unidimensionnelle, inspirée de la pensée et des modes de faire de la société industrielle.”
Un autre modèle possible, en se basant sur le principe “d’archipélisation » Edouard Glissant, Traité du tout-monde. Gallimard, 1997, 268 p., inspirée par la pensée d’Edouard Glissant, envisage bien un passage à l’échelle, mais en adoptant une approche différente. Selon cette pensée, les solutions hyperlocales, une fois connectées, constitueront une masse critique propice à un changement systémique. En prenant en compte que face au monde qui vient, nous allons être contraints de construire des solutions hyperlocales, que des choses qui pourraient fonctionner dans un contexte donné ne seront sans doute pas reproductibles dans un autre contexte.
Transformer la société à l’aune des tiers-lieux
Ce qui se passe à l’échelle du réemploi et sur la question de la réparation, entre institutions publiques et tiers-lieux, n’est que le reflet de ce qui se déroule à l’échelle nationale et internationale sur les choix de mode de vie et de mode de production. Dans son livre Quotidien Politique Geneviève Pruvost, Quotidien Politique, féminisme, écologie, subsistance, La Découverte, coll. « L’horizon des possibles », 2021, 394 p., Geneviève Pruvost estime que « la norme occidentale contemporaine d’existence, c’est la méconnaissance des mains qui agencent, fabriquent et nettoient les objets de la vie quotidienne », conduisant nos sociétés à oublier « la matérialité de ce qui nous fait vivre ».
Il est évident que le projet des ressourceries et recycleries, et des tiers-lieux qui s’engagent à prendre à bras–le-corps la question d’une société qui répare plus qu’elle ne jette, ne peut qu’amener à réinterroger radicalement les causes d’une société du déchet, et par là même le système socio-économique qui soutient ces modes de faire.
Au regard des enjeux du changement de régime climatique, il semble illusoire de continuer à soutenir l’ensemble du système technico-industriel qui mène à l’impasse, comme de penser qu’il est possible de ménager un consensus entre l’ensemble des acteurs. Une voie qui ne peut que freiner la transformation des systèmes productifs et des modes de vie dont dépendra l’habitabilité de la planète pour le XXI siècle. Dans le scénario 1 de l’Ademe, “Génération Frugale”, les clivages “forts et violents dans la société” sont évités “tant que possible” par une “vision égalitaire de la transition”. “Les normes et valeurs évoluent vers une économie du lien plus que du bien, très ancrée sur les territoires et leurs ressources”. Gageons que ces expérimentations existent déjà, et qu’elles se nomment actuellement tiers-lieux.
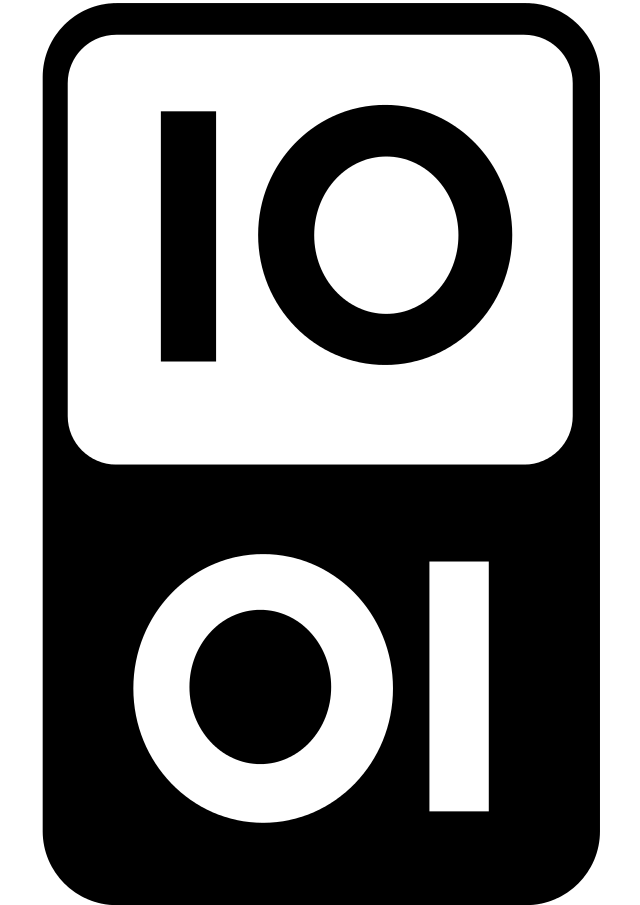
Cet article est publié en Licence Ouverte 2.0 afin d’en favoriser l’essaimage et la mise en discussion.
