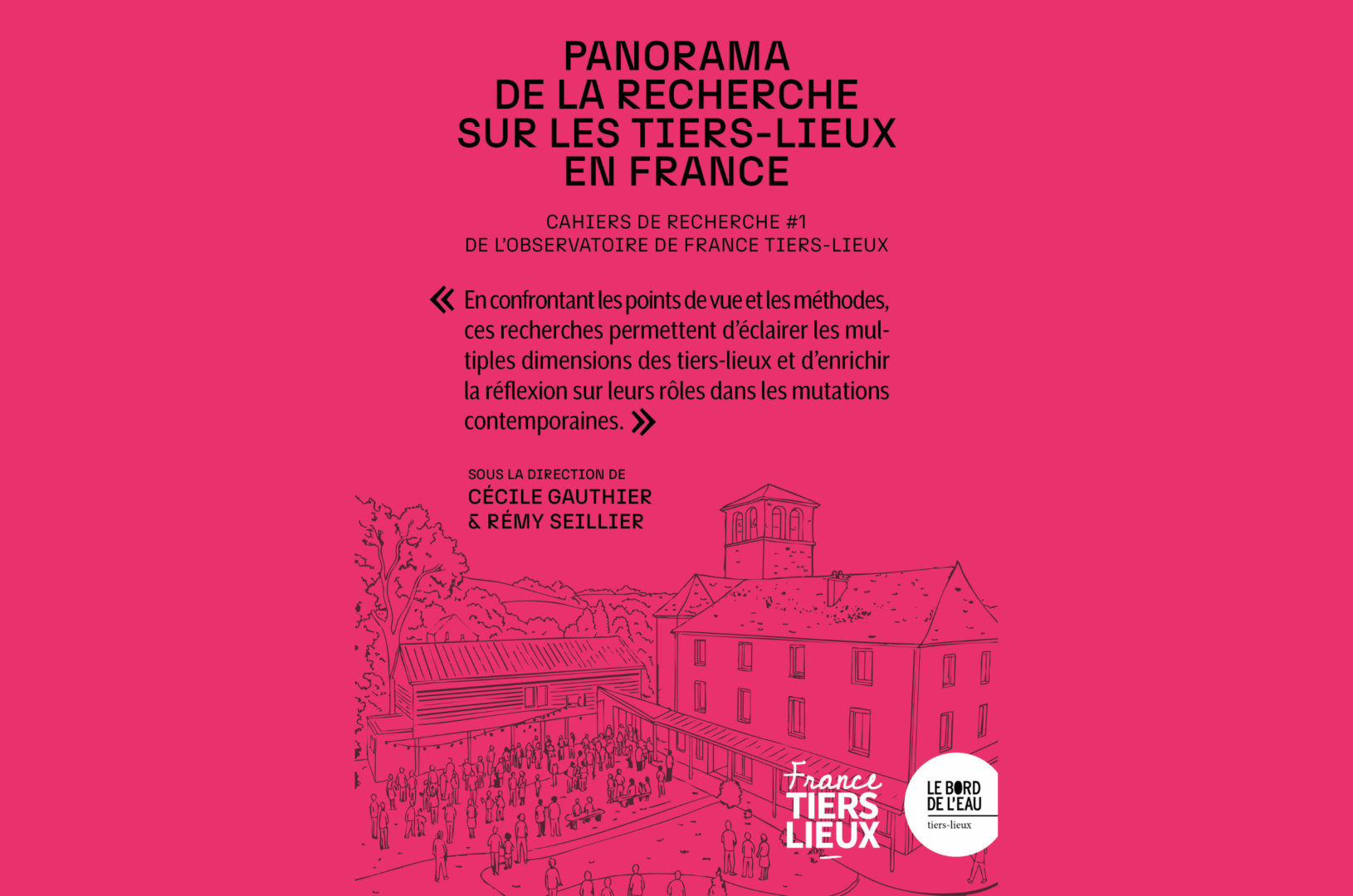Résumé
Découvrez comment la recherche s’est saisie des tiers-lieux. Venez explorer les définitions, les rôles et les effets des tiers-lieux : expérimentations locales, dynamiques de transformation sociale, laboratoires de la transition écologique ou leviers d’une réinvention de l’action publique ? Plongez au coeur des questionnements qui traversent les tiers-lieux et ceux qui les étudient : des modèles économiques traditionnels ou approches par les communs ? institutionnalisation ou récupération ? pourquoi autant de réseaux de tiers-lieux ? quels impacts territoriaux ? lutter contre la gentrification ou y contribuer ? peut-on faire de la recherche en tiers-lieux ? À la fois laboratoire d’idées et outil pour penser l’avenir, ce recueil se présente commune une ressource essentielle pour quiconque s’intéresse à l’évolution et aux enjeux des tiers-lieux.
Pré-commandez l’ouvrage ! Lien vers le site de l’éditeur Lien vers la page des Cahiers de rechercheEclairer les débats sur les tiers-lieux
Les tiers-lieux sont aujourd’hui au cœur d’un engouement sans précédent. Initiatives citoyennes, soutiens publics, reconnaissance institutionnelle, médiatisation croissante : ce phénomène, longtemps resté marginal, est désormais une composante structurante des transformations territoriales et sociales. Pourtant, cette montée en puissance s’accompagne d’une multiplication des usages du terme, de définitions parfois floues et de discours enthousiastes qui ne s’embarrassent pas toujours d’une analyse rigoureuse. La recherche a donc un rôle fondamental à jouer pour objectiver ces dynamiques, les contextualiser et permettre aux acteurs, aux décideurs publics comme aux citoyens, de mieux comprendre ce que recouvrent réellement les tiers-lieux, au-delà des discours et des représentations.
Ces premiers Cahiers de recherche sur les tiers-lieux visent précisément à croiser les travaux académiques pour en dresser un panorama critique. Il ne s’agit pas de figer une définition unique ou d’imposer une vision monolithique des tiers-lieux, mais bien de rendre compte de la diversité des approches, de donner à voir les controverses et d’encourager les débats nécessaires à l’élaboration d’un savoir collectif sur ces espaces en transformation. Les contributions rassemblées dans ce numéro témoignent de cette pluralité de points de vue : certains chercheurs abordent les tiers-lieux sous l’angle de la convivialité et de l’informalité, d’autres les considèrent comme des outils d’empowerment ou encore comme des espaces d’hybridation entre mouvements citoyens et action publique. Loin d’une approche normative, ces travaux permettent d’appréhender les multiples formes et évolutions des tiers-lieux, tout en questionnant leur place dans les dynamiques territoriales et économiques.
La nécessité d’un regard croisé et interdisciplinaire
L’étude des tiers-lieux exige un décloisonnement des disciplines, impliquant la sociologie, la géographie, les sciences de gestion, l’urbanisme ou encore la science politique. Loin d’être un simple concept, le tiers-lieu est un phénomène hybride qui engage des formes variées d’organisations sociales, économiques et institutionnelles. Ces Cahiers de recherche mettent en évidence la nécessité d’une approche interdisciplinaire, à même de comprendre les interactions entre leurs modèles économiques, leurs formes d’institutionnalisation, leur ancrage territorial et leurs effets sur l’action publique, ainsi que leurs fondements ou valeurs intrinsèques.
Bruno Latour nous rappelle que pour comprendre un phénomène en transformation, il faut suivre ses acteurs et les relations qu’ils tissent avec leur environnement. C’est cette approche qui est privilégiée ici : analyser les tiers-lieux non pas comme une catégorie figée, mais comme des espaces – voire des territoires – en mouvement, façonnés par des tensions et des adaptations constantes. En confrontant les points de vue et les méthodes, ces recherches permettent d’éclairer les multiples dimensions des tiers-lieux et d’enrichir les réflexions sur leurs rôles dans les mutations contemporaines.
Dépasser les clivages idéologiques et les fantasmes
Les tiers-lieux suscitent des discours parfois polarisés. Ils sont tantôt perçus comme des espaces de renouveau démocratique et d’innovation sociale, tantôt critiqués comme des outils de dépolitisation ou d’instrumentalisation par les pouvoirs publics. Certaines analyses tendent à opposer de manière caricaturale l’institutionnalisation et l’indépendance citoyenne, alors que les contributions de ces Cahiers montrent que ces processus sont bien plus complexes et souvent imbriqués.
L’enjeu est donc de dépasser ces représentations simplistes pour interroger les dynamiques réelles à l’œuvre. Comment les tiers-lieux évoluent-ils au contact des politiques publiques ? Dans quelle mesure favorisent-ils l’émergence de nouvelles formes de gouvernance collective ? Comment s’intègrent-ils dans les réseaux territoriaux et économiques ? Autant de questions que la recherche permet d’explorer, afin de mieux comprendre les conditions de pérennisation et de transformation de ces espaces.
Donner à voir la recherche pour mieux comprendre et agir
Depuis cinq ans, l’État a investi près de 300 millions d’euros dans le développement des tiers-lieux. Une telle mobilisation de fonds publics appelle une évaluation rigoureuse de leurs effets et de leurs impacts. Quelles transformations économiques, sociales, écologiques, culturelles ou politiques, ces espaces induisent-ils réellement dans les territoires ? Contribuent-ils à renouveler les modes d’action publique ? En quoi ces dynamiques locales associant les habitants et les acteurs du territoire, notamment les collectivités, renouvellent-elles des formes de coopération locale ?
Ces Cahiers de recherche s’inscrivent dans cette démarche analytique et critique. Ils visent à offrir une vision d’ensemble des recherches en cours, à favoriser les échanges entre chercheurs et praticiens, et à enrichir les réflexions sur les enjeux contemporains des tiers-lieux. Comprendre ces espaces, c’est mieux accompagner leur évolution, anticiper leurs défis et proposer des cadres d’action plus adaptés aux réalités de terrain.
Comité d’orientation et scientifique
- Alice Canabate, Chargée de projet – Programme Nouveaux Lieux – Nouveaux Liens à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, Docteure en Sociologie et chercheure associée au Laboratoire de changement social (LCSP) de l’Université Denis Diderot
- Laurent Gardin, Maître de conférences en sociologie à l’Université Polytechnique, Co-président de la Chaire Nord-Pas de Calais en Économie sociale et solidaire et soutenabilité des territoires
- Cécile Gauthier, Chargée de mission recherche – Observatoire de France Tiers-Lieux, Docteure en géographie et urbanisme, chercheuse associée au Laboratoire du Ladyss Paris 1 Panthéon- Sorbonne
- Mélissa Gentile, Co-Directrice de la Coopérative des tiers-lieux en Nouvelle Aquitaine
- Matei Gheorghiu, Docteur en Sociologie et membre du comité scientifique du Réseau Français des Fablabs
- Christine Liefooghe, Maître de Conférence en Géographie à l’Université de Lille au laboratoire TVE
- Romain Pasquier, Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire Arènes – Chaire « Territoires et mutations de l’action publique », Sciences-Po Rennes / Direction de la recherche
- Rémy Seillier, Directeur général adjoint de France Tiers-Lieux
- Magali Talandier, Professeure à l’Université Grenoble Alpes, responsable de l’équipe de recherche « Villes et Territoires » et adjointe à la direction du laboratoire Pacte.
- Isabelle Turmaine, Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
- Hélène Varlet, Programme de l’ADEME d’actions de recherche concerté « dynamiques sociales et économiques territoriales
Membres contributeurs
- Martine Azam, Docteure en sociologie, maîtresse de conférence à l’université Toulouse Jean Jaurès, membre du LISST CERS et du collège scientifique de Scool, elle travaille notamment sur les trajectoires artistiques, sphères et processus de reconnaissance, insertion dans les marchés de l’art, les friches créatives, tiers-lieux et l’action collective dans les collectifs alternatifs, les territoires, identités locales.
- Hugues Bazin, Chercheur indépendant en sciences sociales et fondateur du Laboratoire d’Innovation Sociale par la Recherche-Action (LISRA) et chercheur associé à la MSH Paris-Nord
- Yann Bergamaschi est fondateur de la Fabrique des santés. Il anime un webinaire mensuel sur le « Faire tiers-lieux en santé » depuis le printemps 2022 et coordonne La Conviviale, un tiers-lieu de santé qu’il a co-fondé à Montreuil (93).
- Isabelle Berrebi-Hoffmann, Sociologie et Directrice de Recherche au CNRS, au sein du Lise (Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique)
- Raphaël Besson, Docteur en Sciences du territoire – Urbanisme, chercheur associé au Laboratoire PACTE, Directeur du bureau d’études Villes Innovations
- Etienne Bou Abdo, Doctorant en Aménagement de l’espace et urbanisme à l’Université du Littoral Côte d’Opale et à l’Université Catholique de Louvain
- Camille Breton, Doctorante en Sociologie Centre Emile Durkheim à l’Université de Bordeaux. Sa thèse financée par le Ministère de la Culture sur les tiers lieux ruraux de Nouvelle-Aquitaine est dirigée par Olivier Chadoin. Elle participe également au programme TiLTeR dirigé par Patrice Tissandier.
- Julien Brunier est médecin microbiologiste, responsable SSE-RSE et membre actif d’associations travaillant à la transition environnementale en santé. Il enseigne sur les notions de communs en santé à l’École des Hautes Études en Santé Publique.
- Antoine Burret est sociologue, spécialiste des tiers-lieux. Il a publié la première thèse doctorale ainsi que le premier ouvrage en langue française dédiés à ce concept. Il a contribué à de nombreux tiers-lieux emblématiques et à des réseaux structurants. En novembre 2023, il a publié son dernier ouvrage intitulé Nos tiers-lieux. Défendre les lieux de sociabilité du quotidien.
- Julie Champagne, Coordinatrice et animatrice au Crefad Loire
- Nathalie Chauvac, Maître de conférences associée au Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) à l’Université Toulouse Jean Jaurès, et sociologue au sein de la coopérative SCOOL de recherche en sciences humaines et sociales
- Karen Christensen, est journaliste, éditrice et autrice d’ouvrages notamment « La maison écologique » (Home Ecology, 1989). Son projet principal en ce moment est une réédition augmentée de l’ouvrage de Ray Oldenburg de 1989 : The Great Good Place : Havens and Hangouts at the Heart of Community, qui sortira en juin 2025.
- Laurence Cloutier, Docteure en sociologie, et ingénieure, elle étudie les questions d’innovation, et les dynamiques des écosystèmes entrepreneuriaux en France et au Québec, dans le cadre de la coopérative de recherche Scool.
- Isabelle Colombet est médecin, enseignant chercheur indépendante (MCU-PH Université Paris Cité en disponibilité) sur les services de santé et l’organisation des soins.
- Fanny Cottet, est doctoreure en géographie et urbanisme à l’Université Paris 1, au laboratoire Géographie-cités. Elle a réalisé sa thèse CIFRE à Plateau Urbain. Son travail porte sur l’accès au foncier et à l’immobilier dans les marchés tendus des acteurs de l’ESS et des tiers-lieux.
- Salomé Cousinié, Doctorante en Sciences Politiques au Laboratoire Triangle à l’Université Lyon 2
- Céline De Mil est doctorante à l’Université Louis Lumière Lyon 2, au laboratoire Environnement Ville et Société. Elle a réalisé sa thèse CIFRE au sein de l’agence d’architecture Encore Heureux. Son travail porte sur les modalités d’émergence d’espaces relevant de l’alternatif
- Hervé Defalvard, est maître de conférences HDR en économie au laboratoire Erudite (EA 437) à l’Université Paris Est Marne la Vallée. Ses thématiques de recherche portent sur l’économie sociale et solidaire et les communs sociaux. Il est responsable de la mention de master ESS, de la chaire ESS – UPEM, de la licence pro GOESS et membre du CAG du Réseau interuniversitaire ESS. Il travaille depuis de nombreuses années avec différents tiers-lieux sur les communs et les coopérations territoriales notamment les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE).
- Gwenola Drillet, Coordinatrice générale du tiers-lieu de recherche l’Hôtel Pasteur à Rennes
- Louis Dupuy, Economiste, Chef de projet Economie de la Soutenabilité à l’APESA
- Ingrid Fasshauer est maîtresse de conférences à l’Université Gustave Eiffel et au laboratoire Dicen-IdF. Elle est l’auteure de plusieurs articles et chapitres d’ouvrages sur les tiers-lieux.
- Constance Garnier, docteure en sciences de gestion, ancienne déléguée générale du RFFlabs et Responsable Grande Cause Numérique à la Fondation de France.
- Adrien Gautier, aujourd’hui gérant de Makers & co, après avoir présidé la partie professionnelle du fablab Artilect. Il développe aujourd’hui le Laboratoire Organique de Lustar et est investi dans plusieurs tiers lieux dont le Roselab, et le FIL porté par les Imaginations Fertiles.
- Pascal Glémain, Maître de conférences en Sciences de Gestion – Management et Economie Sociale et Solidaire, co-fondateur du Laboratoire interdisciplinaire de Recherches en Innovations Sociétales-LiRIS et à l’Université Rennes 2.
- Mathilde Gouteux, Doctorante Cifre en gestion, Aix Marseille Université, CNRS, LEST, Aix-en-Provence
- Pauline Juvenez, Docteure en Sciences de l’Éducation (CREN, Université de Nantes, 2021), travailleuse sociale en IMPro et contributrice au réseau régional des Hauts-de-France la Compagnie des Tiers-Lieux. Intérêts : Art / handicap / tiers-lieux / reconnaissance
- Myriem Kadri Hassani, Doctorante en Cifre en Sociologie au Laboratoire ER 7338 PLEIADE à l’Université Sorbonne Paris Nord et au Laboratoire CLERSE à l’Université de Lille
- Leïla Kebir, Professeure associée et directrice adjointe à l’Institut de géographie et durabilité à l’Université de Lausanne
- Amandine Lebrun, Doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université Côte d’Azur au sein du Laboratoire Transitions Numériques Média Savoirs et Territoires, et coordinatrice du réseau Sud Tiers-Lieux
- Maxime Lecoq, Doctorant en Sociologie et Anthropologie à l’Ecole des Hautes études en santé publique à Rennes et en Cifre à la coopérative Coop’Eskemm
- Evelyne Lhoste, Chargée de recherche à l’INRAE et membre du Laboratoire du LISIS, UPEM, Marne La Vallée
- Christine Liefooghe, Maître de Conférence en Géographie à l’Université de Lille au laboratoire TVES (EA 4477)
- Matina Magkou, Chercheure associée à l’Universitat Obseta de Catalunya (UOC) et post-doctorante à l’Unviersité Côte d’Azur
- Meven Marchand Guidevay, Chargé de projets au sein du tiers-lieu de recherche et association PiNG à Nantes
- Clément Marinos, Maître de Conférence en Economie, membre du Laboratoire d’Econmie et de Gestion de l’Ouest (LEGO – EA2652) Université Bretagne Sud
- Corinne Martin, Maître de Conférence en Sciences de l’Information et de la Communication au Centre de recherche sur les médiations (Crem) à l’Université de Lorraine
- Béatrice Maurines, professeure de sociologie, Université Lumière Lyon 2 et membre du Centre Max Weber (UMR 5283), ses recherches portent sur les systèmes agri-alimentaires alternatifs et la réparation des environnements dégradés.
- Laure Michaud, Doctorante en Géographie et aménagement de l’espace au Laboratoire Habiter à l’Université Reims Champagne-Ardenne
- Pascal Nicolas-Le Strat, Sociologue, professeur en sciences de l’éducation, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, responsable de « Territoires en expérience(s) » (Campus Condorcet, La Plaine Saint-Denis)
- Jean-Yves Ottmann, Docteur en Sciences de Gestion, chercheur associé au Laboratoire DRM Equipe Management & Organisation à l’Université Paris-Dauphine, consultant et enseignant du supérieur
- Lucile Ottolini, Docteure en Sociologie, Psychologue clinicienne, co-fondatrice du tiers-lieu de santé Odile en Bonne Santé, Chercheure associée au Lisis
- Emilie Pamart, Maître de Conférence en Sciences de l’Information et de la Communication au Centre Norbert Elias à l’Université d’Avignon
- Maud Pelissier, Maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication au Laboratoire IMSIC-Toulon, Ingémédia, à l’Université de Toulon
- Nicolas Posta, doctorant en sociologie à l’Université Lumière Lyon 2 et membre du Centre Max Weber (UMR 5283), ses travaux portent sur les enjeux de transition agroécologique de la viticulture en Vallée du Rhône et les alternatives agricoles.
- Fabrice Raffin, sociologue, maître de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne au Laboratoire Habiter le Monde. Il est l’auteur de l’ouvrage Berlin, Genève, Poitiers – Friches industrielles – Un monde culturel européen en mutation (2007), Editions l’Harmattan et co-auteur des ouvrages (Un) Abécédaire des Friches (2023) – (coordonné par M.P. Bouchaudy et F. Lextrait), Editions Sens et Tonka ; Factories of the imagination (2000, (coordonné par F. Bordage) – Ed. de l’Imprimeur.
- Elodie Requillart, Doctorante Cifre en géographie et esthétique, Textes et Culture, Université d’Artois
- Emmanuel Rivat, Docteur en Philosophie et Sciences Politiques et co-fondateur de l’Agence Phare
- Mathias Rouet, Directeur des études au sein de la Coopérative Plateau Urbain
- Antoine Ruiz Scorletti, Historien, et spécialiste de la communication par ses formations initiales, il a participé à de nombreuses enquêtes (recensement France Tiers-Lieux, questionnaires livre Blanc RFFLabs, questionnaires universitaires). Il est aujourd’hui également à la tête du Roselab après l’avoir co-fondé.
- Amélie Téhel, Docteure en Sciences de l’Information et de la Communication et post-doctorante à l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes
- Patrice Tissandier est géographe, enseignant-chercheur à l’université Bordeaux Montaigne et à l’UMR PASSAGES. Il mène actuellement le programme de recherche “TiLTeR : Tiers-lieux, territoires et réseaux”, financé par le Région Nouvelle-Aquitaine, visant à investiguer l’articulation entre proximité spatiale et réticulaire patrice.tissandier@cnrs.fr
- Frédéric Wallet, Co-Directeur du programme de recherche TETRAE à l’INRAE

Cet article est publié en Licence Ouverte 2.0 afin d’en favoriser l’essaimage et la mise en discussion.