Ce grand entretien, porte d’entrée dans le fil rouge de l’institutionnalisation, vient mettre en dialogue deux visions complémentaires sur la place des tiers-lieux dans la fabrique de la société et leur potentiel de transformation – des territoires, des modes de faire, des postures… Discussion croisée entre Juliette Bompoint, ancienne directrice de Mains d’Œuvres, et Nicolas Détrie cofondateur de Yes We Camp.
Elle a dirigé pendant 6 années Mains d’Œuvres à Saint-Ouen, lieu culturel devenu institution, rendez-vous des avant-garde, zone d’expérimentations pluridisciplinaires, ou terre d’accueil pour artistes en résidence. Née en 1997 du terreau industriel de la ville, Mains d’œuvres est depuis lors restée enracinée dans ce vécu social et contestataire du quartier.
Lui a lui créé une autre institution, nomade celle-ci, créée en 2013 sous le nom de Yes We Camp. On la retrouve dans ces tiers-zones appelées d’urbanisme transitoire, jonction entre un passé appelé à disparaître et un avenir à modeler. Aux Grands Voisins ou aux Amarres parisiens, comme au Coco Velten marseillais et ailleurs, il faut en quelques années devenir institution, prendre attache avec l’existant et explorer la mixité culturelle, sociale, et entrepreneuriale.
Dans l’actuelle dynamique d’institutionnalisation du mouvement tiers-lieux, émerge de ces deux expériences une ligne de tension, entre une vision qui privilégierait le maintien d’une dynamique expérimentale, attachée à son contexte et ses parties-prenantes, et mettant la focale sur l’échelle micro ; et une vision davantage macro, attachée à déployer à plus grande échelle les expérimentations territorialisées pour amener un changement systémique dans la fabrique des territoires et des politiques publiques. Rencontre avec Juliette Bompoint et Nicolas Détrie.
En 2019, le conflit entre Mains d’Œuvres et la mairie de Saint-Ouen qui courait depuis 2014 s’est accéléré avec une expulsion par les forces de l’ordre des artistes et des équipes sur place. Ça été un moment fort pour le lieu, mais aussi plus largement pour le mouvement tiers-lieu. Comment s’est passé cet épisode d’opposition avec les pouvoirs publics ?
Juliette Bompoint : Après l’expulsion, on s’est retrouvé du jour au lendemain avec 300 élèves de l’école de musique, 250 résidents, nos équipes et des milliers de spectateurs qui n’avaient plus de lieu. Alors, on a décidé de continuer l’activité chez les gens. Le département nous a aussi accueilli dans les collèges et médiathèques de Plaine Commune et toutes les structures associatives locales nous ont ouvert leurs portes. On a pu continuer le projet dans 40 lieux en même temps, pendant 99 jours.
C’était un geste urbain super fort pour montrer la relation qu’on avait avec notre territoire. Et à côté de la mobilisation locale, il y a eu des échos au niveau national et international : plus de 100 000 personnes ont signé la pétition de soutien, tous les membres du réseau Trans Europe Halles étaient derrière nous, le ministre de la Culture Franck Riester est venu… C’était un mélange d’ancrage hyper local et d’inscription très forte dans des réseaux plus larges.
Parce qu’au-delà de Mains d’Œuvres, ce qui était défendu, c’était notre manière de faire art et territoire. Mains d’Œuvres porte des lieux qui ne sont pas descendants, la programmation est décidée par les artistes et les habitants. On parle d’un « lieu pour l’imagination artistique et citoyenne », ça renvoie à la définition d’une hybridation, d’une manière de faire qui a écrit une page des politiques culturelles.
Comment tu expliques cet assemblage entre ancrage local et reconnaissance à une échelle plus grande ? Est-ce qu’on peut le comprendre à la lumière de l’identité expérimentale du lieu, de sa naissance à partir de la société civile locale ?
Juliette Bompoint : À l’origine, le lieu a été ouvert par les anciens ouvriers de l’usine Valéo, abandonnée depuis 15 ans, qui ont porté l’idée que la mairie de Saint-Ouen achète le bâtiment pour le mettre à disposition de Mains d’Œuvres. En 20 ans, l’association a fait plus de 4 millions d’euros de travaux à la place du propriétaire. C’est aussi une source du conflit avec le propriétaire, surtout quand le maire a changé après 70 ans de communisme.
Le lieu a été traversé par des directions successives, avec chacune des tonalités différentes et des relations variables avec les partenaires publics. Mais au moment de l’expulsion, lorsque nous avions la mairie contre nous, l’État, la Région, le Département et la Métropole étaient de notre côté. Parce que Mains d’Œuvres est un lieu qui avait ouvert une voie d’hybridation pour des lieux culturels, en montrant qu’il n’y avait pas besoin d’avoir un théâtre, une salle de concert, une salle de danse… On peut avoir tout ça dans une fabrique de culture réunie, toujours avec une certaine souplesse.
Ça rejoint l’enjeu de définition des tiers-lieu entre des positionnements individuels et collectifs. C’est un vrai sujet. Je pense qu’on peut opposer d’un côté la vision de Ray Oldenburg, un peu Starbucks, des lieux entre la maison et le travail dans lequel on peut venir travailler entouré de gens. Mais ici, c’est le plaisir individuel et le service qu’apporte le lieu qui est important. Et de l’autre, une définition davantage basée sur les communs d’Elinor Ostrom, avec la volonté de prendre collectivement possession d’un espace pour se le réapproprier, réinventer des formes de démocratie et de gouvernance. Ici, ça passe par plutôt par des formes de programmation artistique, d’ouverture et de propositions spontanées. C’est dans cette seconde approche que s’inscrit Mains d’Œuvres.
Est-ce que cette opposition proposée par Juliette te parle Nicolas ? On retrouve cette même philosophie au sein de Yes We Camp ?
Nicolas Detrie : Tout à fait. Je ne me sens pas en tension avec Mains d’Œuvres sur cette approche. Face au populisme anti-écologique et aux discours de repli sur soi déployés en ce moment, j’ai envie d’être dans l’équipe qui essaye de montrer qu’il est possible d’être plus accueillant, de s’hybrider, d’avoir une économie plus artisanale ou de sortir de la société de consommation.
Et la meilleure manière que j’ai trouvée pour le faire, ou en tout cas celle où je me sens bien, c’est de faire exister des espaces dans lesquels autre chose se passe : de l’hospitalité, des communs, de l’invention, des rencontres, le tout accessible au grand public. Des sortes de preuves par l’exemple, des mini-mondes dans lequel naissent ce sentiment de pouvoir prendre part. Ce sont des endroits où les gens peuvent venir bosser, parfois c’est davantage artistique, ou avec des fonctions sociales très affirmées. Mais le cœur de l’intention, c’est de montrer des alternatives et de ringardiser le discours dominant.
L’histoire de Yes We Camp s’est tissée à partir de dizaines de lieux, dans des villes très différentes partout en France, comment le collectif aborde-t-il la question de l’ancrage local ?
Nicolas : La plupart du temps, quand on arrive sur un territoire, nous sommes des étrangers. On est un peu dans le « ici et ailleurs » chez Yes We Camp et je suis toujours un peu mal à l’aise avec les discours « c’est le local qui doit faire le local ». On a parfois l’impression que plus on va dans les quartiers populaires, plus on est illégitime à y être présent si on n’y est pas né. Ce que je trouve terrible et hyper excluant. Ça contribue à ghettoïser, à fermer ces espaces sociaux. D’ailleurs, quand j’arrive, je dis toujours que je ne suis pas issu du territoire, mais que j’ai envie d’être là en ce moment, c’est qui est important au fond.
Il y a aussi la question des besoins. On entend parfois qu’un tiers lieu doit répondre d’abord aux besoins directs du territoire. Mais quand je vais dans les quartiers nord, à Marseille, les besoins du territoire, ce sont des docteurs, de l’alimentation saine, de la sécurité, des choses élémentaires et indispensables. Quand on reprend les 16 hectares du parc de Foresta pour en faire un lieu de promenade, d’imagination, de nature propice au sentiment de liberté, on ne répond pas du tout aux besoins.
Au début, les directeurs de centres sociaux se demandent d’ailleurs souvent ce qu’on fait là mais l’on prend le temps de la rencontre, et à la fin, ce sont eux qui défendent le projet. Parce que les familles avec qui ils travaillent viennent sur le lieu, se l’approprient.
Le fait d’être impliqué sur beaucoup de lieux, sur des territoires variés, motivés justement par cette volonté de créer partout des preuves par l’exemple, ne signifie pas que l’on sort d’une logique contextuelle et expérimentale.
Juliette : C’est vrai qu’il y un besoin de cultiver les imaginaires quand on s’installe quelque part, c’est-à-dire d’arroser comme des graines les personnes et les projets qui sont déjà là, en les faisant participer. C’est une question de posture, d’attitude envers l’autre, il n’y a pas forcément besoin d’être issu du territoire.
Nicolas : Dans une conférence, le jardinier Gilles Clément explique que le travail d’un jardinier, pour transformer son environnement, c’est au départ d’intervenir pour amender un peu la terre et pour planter. Mais très rapidement, des choses arrivent d’elles-même, et il faut se contenter de composer avec ce qui existe. Je trouve que l’on fait beaucoup ça. Quand on arrive, on est très volontaire, on intervient pour créer un espace fertile. Puis c’est l’art de la composition. Et idéalement, quand les choses aboutissent, la gouvernance, la codécision, l’identité se construisent progressivement.
Juliette : À ce sujet, j’adore la notion de biodiversité culturelle. On dit souvent qu’il faut laisser des terrains en friche pour que la biodiversité puisse revenir et soit préservée. Ça fonctionne aussi pour les lieux culturels : il faut laisser des lieux en friche pour que les artistes et les habitants reprennent leurs droits, s’en emparent en toute liberté et créent de la diversité artistique et culturelle.
Les lieux de Yes We Camp, comme Mains d’œuvre à l’origine, ont pris racine dans des bâtiments ou terrains inoccupés, souvent dans une logique d’urbanisme transitoire. Qu’est-ce qu’induit cette logique du temporaire ? Est-ce que vous envisagez de pérenniser les lieux ?
Nicolas : Pour moi, l’enjeu c’est d’avoir de gros lieux et de les avoir en entier. Ce n’est pas tellement la durée. Je trouve que les gros lieux permettent de donner de la force à notre démarche de preuve par le réel, tout en étant vraiment utiles aux territoires.
Aujourd’hui, cette durée courte et limitée est un peu le salaire pour avoir accès à ces gros lieux, sans les payer. On avait pensé à une foncière pour acquérir notre lieu Coco Velten, à Marseille, mais finalement, on n’avait pas envie de l’acheter. On s’est tellement bâti sur un discours de non-propriété, en affirmant que ces projets marchaient parce que ces lieux n’appartiennent à personne. Par exemple, si les Grands Voisins appartenaient à Yes We Camp, il y a beaucoup de projets très engagés qui n’auraient pas été menés en son sein. Parce que les artistes ou habitants n’auraient pas voulu rouler pour nous.
Juliette : Tu peux toujours leur proposer de participer à la foncière (La Main, Foncièrement Culturelle), pour que le lieu appartienne à tout le monde. Si le lieu appartient à tout le monde, c’est comme s’il appartenait à personne.
Nicolas : Il y a déjà quelque chose qui permet au lieu d’appartenir à tout le monde, c’est la propriété publique. C‘est pour ça qu’on encourage la ville de Paris à garder le bâtiment des Grands Voisins.
Juliette : Mais le public est soumis à des politiques qui ne vont pas forcément dans notre sens et qui peuvent même devenir carrément craignos. Donc autant l’acquérir collectivement pour garder la main dessus.
Nicolas : Dans ce cas-là, le « tout le monde » va probablement être une communauté intentionnelle de gens qui se ressemblent.
Comment fonctionne le foncier du côté de Mains d’œuvre ?
Juliette : On n’achètera jamais le bâtiment de Mains d’Œuvres, c’est la propriété de la ville et elle ne veut pas nous le vendre. Par contre, on a créé une coopérative d’intérêt collectif (SCIC) – La Main, Foncièrement culturelle – qui fonctionne comme une foncière agricole. Les modèles, c’est Terres de Liens et le Meithauser Syndikat, à Berlin. Ça permet aux artistes, aux habitants, aux associations de devenir collectivement propriétaires des lieux. Là-dessus, on est soutenu par le ministère de la Culture.
L’enjeu c’est donc d’arriver à mobiliser au moins 30 000 personnes sur le sujet, pour avoir 100 lieux en France qui appartiennent à tout le monde. Ça me semble être une bonne solution collective, mais si tout le monde fait sa foncière dans son coin, ça ne marchera pas. Il en faut une seule qui réunit la dynamique.
Nicolas : Je comprends comment ça peut marcher pour du logement, ou de l’agriculture, mais je ne vois pas pour les tiers-lieux. Je ne vois pas comment les recettes de fonctionnement peuvent financer l’investissement.
Il y a donc une volonté chez Mains d’Œuvres de remettre en question ce caractère transitoire qui fait l’identité de beaucoup de tiers-lieux culturels ?
Juliette : Oui, c’est une des grandes différences entre Nicolas et moi. J’interroge la notion de transitoire pour affirmer que nous ne sommes pas des outils de transformation urbaine, qui produisent de la gentrification ou qui servent les intérêts d’un promoteur immobilier ou d’une collectivité. Nous devons être des acteurs de la transition, des acteurs plus durables. Et la foncière permet justement de rendre nos lieux définitifs, d’en faire des vrais communs culturels.
Nicolas : De mon côté, je pense qu’un commun c’est avant tout une communauté autour de règles. Nos lieux sont assez rapidement perçus comme des ressources, soit en tant qu’espaces pour organiser des évènements par exemple, mais aussi dans la pratique du lieu : ce qu’on peut y apprendre, s’épanouir, se sentir bien… Comme il y a du multi-usage, il doit y avoir des règles pour organiser une communauté d’usagers parfois hétérogène.
Ce que j’aime bien, c’est que cette communauté se crée autour des usages, pas autour de l’idée des communs. Les gens viennent surtout parce que c’est utile, parfois parce que c’est la galère et que c’est l’endroit le plus efficace pour combler les besoins. À partir de là, on n’est plus dans la société de la propriété et de la consommation, on est dans le partage d’un endroit, des attitudes, des identités.
Nicolas, si l’enjeu n’est pas forcément de devenir propriétaire des lieux, comment aller plus loin ?
Nicolas : Je pense que la prochaine marche, sur les questions d’institutionnalisation, c’est d’être dans le plan de relance France 2030, dans les stratégies de décarbonation, de planification économique et écologique. Il y a des milliards d’euros en jeu qui ne sont dédiés qu’aux industries pour l’instant. Il faut revendiquer que l’on représente des endroits qui proposent d’autres manières de vivre ensemble, qui permettent d’éviter des fractures et des crises sociales comme les gilets jaunes, les bonnets rouges ou la colère des agriculteurs. Il faut qu’on soit reconnu non pas comme des animateurs socio-culturels ou artistiques, mais bien comme des acteurs de long-terme.
Juliette : Je défends un urbanisme circulaire dans lequel il faut construire des modèles soutenables, même lorsqu’il s’agit d’une occupation transitoire. C’est ce que fait Yes We Camp d’ailleurs. Pour ça, il faut arriver à se projeter et à déplacer les équipes, le matériel et les savoir-faire lorsqu’on change de lieu pour transmettre au mieux les méthodologies de travail avec le territoire. Et en effet, il faut aussi que les pouvoirs publics investissent en nous, qu’ils acceptent que ce que l’on fait, c’est de l’investissement dans la société.
Ce passage à une autre échelle passe aussi par une logique d’essaimage au-delà de vos associations. C’est l’intention derrière le Diplôme Universitaire Espaces communs lancé par Yes We Camp ?
Nicolas : Avec les collègues, quand on essaye de formaliser ce qu’on a fait jusque là, on identifie trois étapes. Une première où on a fait exister quelque chose qui n’existait pas. Il y avait de la place, on a pris des lieux en fonctionnant de manière plutôt intuitive. Ensuite, il y a eu ces dernières années un mouvement retour, avec une diversité de situations qu’on a pu analyser en se demandant : qu’est ce qu’il y a de commun dans tout ça ? Et désormais, on est dans une troisième phase où l’objectif est de comprendre comment des lieux peuvent apparaître un peu partout sans que nous soyons forcément là.
Juliette : C’est là que c’est le plus dur : réussir à faire en sorte de créer et de laisser des lieux où les gens se sentent responsables d’un espace.
Nicolas : On est souvent sollicités, mais on est déjà investi dans huit lieux et ce n’est pas prévu qu’on en ait d’autres. Et puis notre équipe est plutôt à Paris et à Marseille. Donc on accepte de faire des études, mais on a beaucoup dit qu’il ne faut pas que ce soit nous qui portions le projet, surtout lorsqu’il y a des gens en local.
Sur ce point, il y a quelques belles histoires avec des groupes locaux bien constitués qui ont réussi à porter leur projet. Mais dans l’ensemble, c’est assez contrasté. Il y a aussi beaucoup de cas où les clés ont été confiées localement et il ne s’est rien passé, ou mal passé pour différentes raisons. Les deux options existent : Yes We Camp envoie des salariés pour le faire, ou alors nous faisons une étude qui propose un modèle juridique et économique dont peut se saisir le local. Toutefois, j’ai l’impression que ni l’une, ni l’autre ne fonctionne à tous les coups.
C’est pour ça qu’il est intéressant de réfléchir aux dispositifs d’accompagnement et de partage d’ingénierie. Car il y a de l’ingénierie, il y en a même beaucoup et elle est assez subtile. Paul Citron de Plateau Urbain parle de « DJ des usages », j’aime beaucoup : il ne suffit pas d’avoir de bons disques, il faut savoir quand et comment les articuler. C’est la même chose pour les usages, pour s’assurer de créer un lieu fonctionnel, généreux et collectif.
Et puis il y a pleins de métiers très imbriqués, le tout dans une dynamique foisonnante qui doit rester ouverte. Il n’y a pas de recette miracle, mais il y a une forme de savoir-faire derrière tout ça. D’où le projet du Diplôme Universitaire Espaces Communs qu’on a monté en partenariat avec Ancoats, Codesign-it, French Impact et l’Université Gustave Eiffel.
Juliette : C’est un beau modèle qui permet de transmettre ces méthodologies, ces manières de faire, d’immerger les apprenants dans des écosystèmes, de les rendre eux-mêmes acteurs de leur propre formation. Ce DU est une des bonnes solutions pour essaimer nos pratiques. À côté, il faut vraiment qu’on continue de transmettre, de partager, de s’ouvrir, d’être le plus transparent et coopératif possible. Même si on a pas toujours le temps ou l’énergie.
Et sur des sujets comme le foncier, je pense qu’il est particulièrement pertinent de travailler à l’échelle européenne. Avec le réseau Trans Europe Halles, on est déjà plus de 150 lieux, à travailler ensemble depuis 40 ans pour créer une forme de solidarité à grande échelle. On en a besoin.
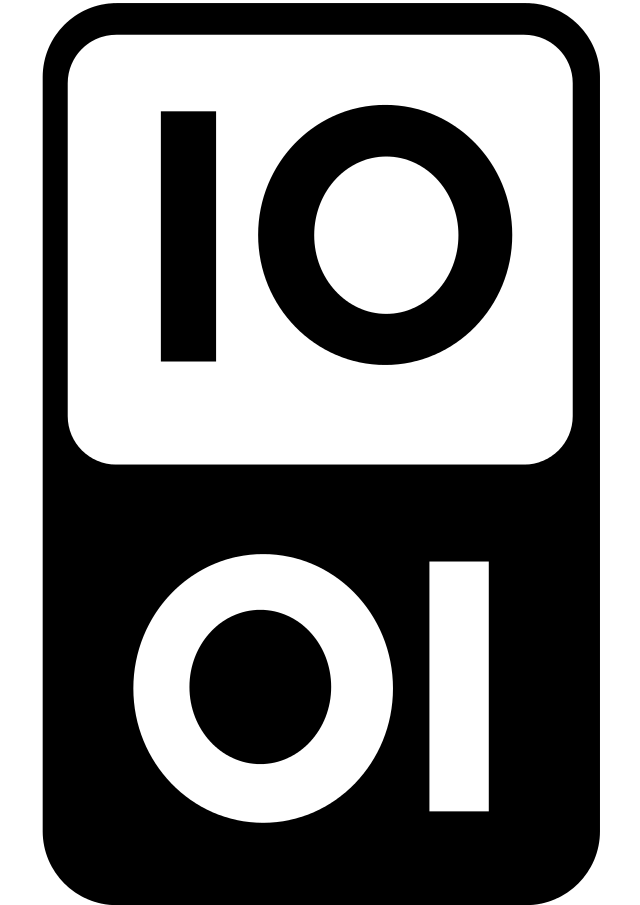
Cet article est publié en Licence Ouverte 2.0 afin d’en favoriser l’essaimage et la mise en discussion.
